NOTES sur PENNEDEPIE – 14
de Penapisce
Archives Calvados.
Pennedepie (Calvados) Canton actuel : Honfleur-Deauville
Arrondissement actuel :Lisieux – Code INSEE : 14492
Deux pleins fiefs de Chevalier, assis en la paroisse de Pennedepie, possédés par Robert Mallet, Ecuyer, sieur de Saint-Martin.
Barbe de Sallenove, possède les fiefs de Blosseville (commune de Pennedepie) en 1519; elle épousa Jean de Nollent.(La Roque de la Lontière, Gilles A.).Jean de Nollent Seigneur de Saint Leger marié à Damoiselle Marguerite de la Heruppe avec laquelle il vivoit l’an 1406. dont ils fournirent la descente; les héritiers de Pierre de Nollent de la Parroisse de Pennedepie furent aussi approchés. Blosseville appartenait, au XVIe siècle, à la famille de Nollent et, au XVIIIe, à la famille Malet.
Collection de Répertoires Sommaires des Documents antérieurs à 1800, Conservés dans les Archives Communales.
PENNEDEPIE
I. Dioc. de Lisieux . Baill. de Honfleur. Maîtrise de Pont-l’Évêque. Gr. à sel de Honfleur. – Gén. et int. de Rouen ; él . de Pont-l’Évêque; subd. de Honfleur.
II . Distr. de Pont- l’Évêque ; canton de Honfleur (Arrêté du 1er mars 1790) .
III. 3º arr . communal (Arr. de Pont- l’Évêque) ; canton de Honfleur ( Loi du 28 pluviôse an VIII et arrêté du 6 brumaire an X) . – Pop.: 316 hab. ( 1911) . – Sup.: – 585 hect. 84 a. 21 c.
ADMon Gale Délibérations. 8 mars 1788-10 nivôse an IV (4 cah. , 10, 31, 47, 89 fol. )
Reprise des délibérations : 15 pluviôse an IX.
ÉTAT-CIVIL. Baptêmes. 1591-1602.- Sépultures. 1621-1626 .
Baptêmes, mariages et sépultures, depuis 1646.
Lacunes : 1624, 1667, 1697-1699. – Délibérations du commun.
1647-1671 , 1674-1683 ; délibérations et comptes du trésor, passim , adjudications des cierges des confréries dans le registre de 1700-1739. Notes sur des procès au sujet des dîmes contre le prieuré de Beaumont et contre le seigneur de la paroisse .
IMPOSITIONS. -États de sections (Sections A- B, D) . An V ( 3 cah. ,47 fol.)
Voir Ibid., les délibérations du Comité de surveillance de Pennedepie, 24 frimaire an II- 20 vendémiaire an III (Reg. )
Pennedepie: rôle d’imposition pour les travaux du presbytère . 1757-1758;
Dictionnaire Topographique Du Département Du Calvados C. Hippeau .
Pennedepie, canton de Honfleur. Penapisce, Pennapie, XIV° s° (pouillé de Lisieux, p. 40). Par. de Saint- Georges, patr. l’abbé de Saint-Ouen de Rouen. Dioc. de Lisieux, doy. de Honfleur. Génér. de Rouen, élecl. de Pont-l’Evêque, sergent. de Touque. Deux pleins fiefs de Blosseville, mouvant de la bar. de Fauguernon, 1620 (fiefs de la vicomté d’Auge).
Bouillette (La), h. – Brèche-des-Bois (La), h. – Brunets (Les), h – Mont-Essart, q. – Planche-de-Pierre (La), q. –
– Quatre-Nations (Les), h – Sergenterie (La), h – Vert-Val (Le), h –
1 – Bibliographie.
2 – Pièces Justificatives.
3 – Archives ShL.
1 – Bibliographie:
CAUMONT Arcisse de : Statistique monumentale du Calvados.
Editions Flohic: Le Patrimoine des communes du Calvados, page 937.
Revue le Pays d’Auge: Guy Bougerie, Dans une trouée de la forêt augeronne (le châlet Guttinguer) – Pennedepie 1984-09-sept.
2 – Pièces Justificatives:
STATISTIQUE MONUMENTALE DU CALVADOS PAR ARCISSE DE CAUMONT.
Notes par M. V. Pannier.
Pennedepie, Pennapisce, Sanctus Georgius de Pennapice,
L’église de Pennedepie, bâtie sur un monticule, à peu de distance de la mer, domine un charmant vallon que traverse le chemin de moyenne communication de Trouville à Honfleur.
Les parties les plus anciennes de cette église, qui présente aujourd’hui peu d’intérêt, remontent au XIIe. siècle.
Le portail occidental, précédé d’un grand nombre de degrés, est construit en travertin. Les deux contreforts peu saillants, placés aux extrémités, s’élèvent presque jusqu’au sommet du gable qui est tronqué. Une porte cintrée, en pierre, donne entrée dans la nef. Cette porte, qui date seulement du siècle dernier, est flanquée de deux contreforts, à double glacis, élevés au XIIIe. siècle. Au -dessus se montrent les vestiges d’une fenêtre ogivale, dont la forme accuse aussi le XIIIe. siècle.
Un petit clocher, en forme de campanile, couronne le portail. Il renfermait, au commencement de ce siècle, une ancienne cloche qui provenait, dit-on, de la vieille église Notre-Dame d’Honfleur.
Le mur méridional de la nef présente une décoration sévère dans le genre de celle de l’antique chapelle du prieuré du Mont-Argis, située près de Cambremer. De grandes arcatures à plein-cintre, aujourd’hui défigurées, encadraient les fenêtres primitives, remplacées par des ouvertures sans caractère.
Le choeur, reconstruit en grande partie, est placé sur la même ligne que la nef, à l’exception de la dernière travée qui est ancienne. Il est éclairé de chaque côté par des fenêtres cintrées, modernes, semblables à celles de la nef.
A l’intérieur, une épaisse couche de badigeon, d’une blancheur irréprochable, couvre les anciens murs ainsi que la voûte.
Le maître-autel offre un joli retable, dans le style Louis XIV, décoré de deux colonnes torses, d’ordre corinthien, autour desquelles s’enroulent des ceps de vigne, chargés de grappes de raisin.
Au XIVe. siècle, l’église de Pennedepie dépendait de la célèbre abbaye de St.-Ouen de Rouen ; elle est sous l’invocation de saint Georges.
Avant la Révolution, le présentateur à la cure était le prieur de Beaumont-en-Auge, d’après l’Almanach de Lisieux pour l’année 1774, imprimé par Mistral.
Moulin.
— Au fond du vallon coule un ruisseau qui fait mouvoir un ancien moulin dont la construction remonte au XVIe. siècle. Le rez-de-chaussée, bâti en travertin, est surmonté d’un étage en charpente avec tuiles entre les colombages.
Une jolie lucarne en bois, à deux baies cintrées, fait saillie sur le toit.
On comptait 2 feux privilégiés et 61 feux taillables à Pennedepie.
Inventaire historique des actes transcrits aux insinuations ecclésiastiques de l’ancien Diocèse de Lisieux – PIEL L.F.D.
615. — Le 29 juin 1702, la nomination à la cure de St-Georges de Pennedepie appartenant au prieur de Beaumont-en-Auge , Mesre Denis François Bouthillier de Chavigny, évêque de Troyes, prieur commendataire de Beaumont-en-Auge, nomme à lad. cure, vacante par la mort de Me Olivier Isabel, dernier titulaire, la personne de Me Michel Audran, pbrë du diocèse de Rouen, bachelier en théologie de la faculté de Paris.
Le 1er juillet 1702, la nomination à la cure de Pennedepie n’ayant pas été faite dans le temps fixé par le droit, le seigr évêque y nomme la personne dud. sr Audran. Le 8 juillet 1702, sur la présentation faite par le prieur de Beaumont led. seigr évêque donne aud. sr Audran la collation de ce bénéfice.
Le 15 août 1702, la nomination à la cure de Pennedepie revenant au roy, à cause du litige formé entre ceux qui se prétendent patrons de cette cure, Sa Majesté y nomme aussi la personne du sr Audran. Le 12 déc. 1702, le seigr évêque lui donne de nouvelles provisions de ce bénéfice.
Le 15 déc. 1702, le sr Audran, demeurant à Paris, rue Ste Anastase, donne sa procuration pour prendre possession de la cure de Pennedepie.
38. — Le 30 oct. 1703, M4 Michel Audran, pbrë du diocèse de Rouen, bachelier en- théologie de la faculté de Paris, pourvu de la cure de Pennedepie, demeurant à Paris, représenté par Me Henry-Joseph Hannegué de Hardencourt, pbre, vicaire desservant lad. parr, de Pennedepie, prend possession de ce bénéfice, en présence de Messre Raymond du Cup, seigr d’Issul, lieutenant pour le roy au gouvernement de Honfleur, et plusieurs paroissiens de Pennedepie.
100. — Le 29 déc. 1703, Me Jean-Baptiste Moullin, pbrë, promoteur de l’évêché, expose au seigr évêque « qu’après le décez de feu Me Ollivier Isabel, pbrë, curé de Pennedepie il ne s’estoit présenté
d’héritiers absolus, mais bien Guillaume et François Isabel, ses frères, se disant héritiers par bénéfice d’inventaire, lesquels en cette qualité et d’intelligence avec le nommé Gaudry, dépositaire des deniers provenus de la vendue des meubles dud. feu sr Isabel, curé de Pennedepie, auroient fait adjourner en bailliage à Pont-l’Evêque led. Gaudry pour représenter lesd. deniers, ce qui a esté dénoncé au suppliant par le sr de la Croix, ci-devant promoteur, et d’autant qu’il est de l’intérest du suppliant que lesd. deniers ne soient divertis et lesquels font l’assurance des réparations qui sont à faire tant au chancel que maisons presbytérales de la parr. de Pennedepie, à quoy led. feu sr curé était obligé. » Mais l’official se refusant à connaître de cette affaire, dans laquelle il peut être regardé comme intéressé, attendu que son neveu, Me Michel Audran, qui est pourvu dud. bénéfice, « et les autres officiers et avocats de l’officialité étant récusés à raison du procès qu’ils ont actuellement en
la cour de parlement contre le feu sr curé», led. sr promoteur prie le seigr évêque « de nommer une personne, ayant les qualités requises, pour faire les fonctions de juge en ce procès. » Vu lad. requête, le seigr évêque nomme « pour juge en cette partie, pour juger sur la contestation des réparations du presbytère, chancel et autres lieux à la charge desd. héritiers » la personne du sr de Langottière, docteur de Sorbonne.
Pennedepie (Saint Georges).
Curés. — O. Isabel — M. Audran.
Vicaires. — Levavasseur — H.-J. Hennegué de Hardencourt.
Prêtre desservant. — Prenthout.
Patronnage. — Litige entre l’évêque de Lx et D.-F. de Bouthiller de Chavigny, prieur commendataire de Beaumont-en-Auge – Le roi ob litem.
613. — Le 9 février 1722, vu l’attestation du sr Jean, pbfë, desservant la parr, de Pennedepie, et du sr Valsemey, vicaire de Barneville, dispense de bans pour le mariage entre David Le Mire et Gabrielle Liétout.
Pennedepie (Saint Georges).
Curé. — M. A. Audran.
Vicaire. — H. Hennegué de Hardencourt.
Prêtre de la paroisse. — Jean (D).
547, — Le 19 août 1728, dispense de bans pour le mariage entre Albert Rebut, sr de Lépiney, fils de Guillaume Rebut, conser du roy, auditeur en la chambre des Comptes de Rouen, et de feue Catherine
Dubusc, de la parr . St-Jean de Rouen, d’une part, et Marie-Thérèse Audran, fille de feu Philippe et de feue Jeanne Leroy, de la parr. De Pennedepie.
Pennedepie (Saint Georges).
Curé. — M -A. Audran.
Vicaires. — N. Delafosse. — G. Thillard.
Prêtre de la paroisse. — P. Gucroult, XVIII. 479.
Seigneur et notable. — J. de Naguet. — M.-T. Audran.
166. — Le 8 janv. 1756, Me Michel-Alexandre Audran, curé de Pennedepie et prieur commendataire du prieuré simple régulier de St Jean de Boisroland, diocèse de Luçon, étant en son lit dangereusement malade, donne sa procuration pour résigner led. prieuré entre les mains de N.-S.-P. le pape en faveur de son neveu, Me Louis Magin, pbre du diocèse de Rouen, curé d’Eturqueraye, aud. diocèse. Le sr résignant se réserve toutefois une pension viagère de 600 livres à prendre sur les revenus dud. bénéfice qu’il a possédé pendant trente-huit ans. Fait et passé au manoir presbytéral de Pennedepie, en présence de Mesre Philippe-Louis Le Jumcl, chevr seigr de Barneville et de
Pennedepie, demeurant à Barneville ; Me Louis Le Sueur, pbfè, demeurant à Pennedepie, et autres témoins. — Le sr Audran n’a pu signer, à cause de la maladie et de la faiblesse de son bras.
175. — Le 27 janv. 1756, Me Michel-Alexandre Audran, pbrë, docteur de Sorbonne, curé de Pennedepie, étant en son lit dangereusement malade, donne sa procuration pour résigner sad. cure entre les mains du seigr évêque de Lx en faveur de Me Guillaume Tillard, pbrë du diocèse de Bayeux, curé de Hennequeville, exemption de Fécamp , et led. sr Tillard, se trouvant actuellement au manoir presbytéral de Pennedepie, donne aussi sa procuration pour résigner sad. cure de Hennequeville entre les mains des srs abbé et religieux de l’abbaye de Fécamp, en faveur dud. sr Audran, pour cause de mutuelle permutation. Fait et passé aud. manoir presbytéral de Pennedepie, en présence de Me Louis
Le Sueur, pbfë, vicaire de Pennedepie ; Me Etienne-Pierre Desclosets, conser du roy, grènetier au grenier à sel d’Honfleur ; Me Jacques-Charles Le Roy, notaire royal à Honfleur, tous deux demeurant en lad. ville, parr. Ste Catherine. — Le sr Audran a déclaré ne pouvoir signer, à cause de sa maladie et de la faiblesse de son bras. De plus, led. Sr Audran donne plein pouvoir à son neveu, Me Charles Joseph Roussel, pbfë, de prendre, en son nom, possession de la cure de Hennequeville, en vertu de l’institution canonique qui interviendra. Le même jour (27 janv.), le seigr évêque donne aud. sr Tillard, la collation dud. bénéfice de Pennedepie.
Ce fut le sr Tillard qui courut lui-même à Lx demander son institution canonique et fit insinuer ces divers actes. Le30janv. 1756, Me Bernardin Lemonnier, pbrê, Me ès-arts en l’Université de Caen, demeurant à Pont-l’Evêque, requiert en sa qualité de gradué, des religieux de Beau mont, en parlant à Dom Jean-François de la Varerme, pbrê, procureur de lad. abbaye, sa nomination à la cure de Pennedepie, vacante par la mort de Me Michel-Alexandre Audran, pbrê, dernier titulaire. Le sr dela Varenne répond qu’il consent que; led. sr Lemonnier fasse ses diligences pour posséder led. bénéfice.
Le 2 févr. 1756, le seigr évêque donne aud. sr Lemonnier la collation de cette cure. Le 6 févr. 1756, le sr Lemonnier (1) prend possession du bénéfice cure de Pennedepie, en présence de Me Louis Magin, pbrê, curé de la parr. d’Eturqueraye, diocèse de Rouen ; Me Jean-Jacques Logre de la Roche, pbrê, demeurant à St-Gatien-des-Bois ; Me Charles-Joseph Roussel, pbfë, curé d’Etreville, diocèse de Rouen, et autres témoins.
La Révolution trouva Mr Lemonnier à Pennedepie. Quand on lui demanda le serment à la Constitution civile du clergé, il fil un long discours pour montrer la légitimité de ce serment et il le prêta purement et simplement, ainsi que Mr Gosset, son vicaire. Il passa tout le temps de la Révolution dans le presbytère qu’il s’était construit et qu’il racheta quand cette maison fut vendue comme propriété nationale. Après le Concordat, il ne parait pas avoir repris ses fonctions pastorales, quoique le nécrologe de l’Ordo lui donne le titre de desservant de Pennedepie. Cédant aux bons conseils M. Opoix, curé de Vasouy, il se réconcilia avec Dieu et mourut en 1803. Mr Opoix, qui le remplaça, ne le suivit pas de loin dans la tombe. (Archives du Calvados et Ordo de Bx.)
314. — Le 6 mars 1756, le R. P. Dom Joachim de Bailleul, ayant assemblé la communauté (des religx de Beaumont) en la manière accoutumée, luy a représenté qu’après le déceds du sr Audran, curé de la parr, de St-Georges de Pennedepie, la communauté auroit nommé aud. bénéfice le sr Hemery, faute par les gradués sur notre dit prieuré de s’estre présentés pour requérir led. bénéfice ; mais que depuis lad. nomination, le sieur Lemonnier, gradué en règle, aurait requis ledit bénéfice ; à laquelle réquisition il auroit esté fait réponse par Dom de la Varenne, notre procureur, qu’il consentoit que ledit sieur Lemonnier fasse ses diligences pour posséder ledit bénéfice-cure de Pennedepie, ainsi qu’il avisera bien : ce qu’il auroit signé. Mais comme ledit sieur Lemonnier a requis de la Communauté de vouloir bien approuver et ratifier la réponse dud. procureur, l’affaire mise en délibération, il a
esté conclu unaniment que les religieux-profès dud. prieuré approuvaient de leur seing manuel lad. réponse dud. père procureur. Ce que nous avons signé. » Signés : Fr. René Dumesnil ; Fr. Joachim Bailleul ; Fr. H. Plasnier, secrétaire du Chapitre ; Fr. N. Fauvel, sous-prieur ; Fr. J. -François de la Varenne, procureur ; Fr. J.-B. Grandhomme ; Fr. Henry Le Balleur ; Fr. Mat. Crucefix ; Fr. Charles Vigneron ; Fr. L. Fr. Carrey, tous avec paraphe.
317. — Le 5 avril 1756, Me Jacques Monsaint, pbrë, Me ès-arts en l’Université de Caen, chapelain de la chapelle St-Eloy, en la pair, du Mesnil-Hubert, « lequel a pris possession canonique du bénéfice cure de St-Georges de Pennedepie, de la valeur de viron quatorze cents livres de revenu annuel, duquel mesme bénéfice maitre Bernardin Lemonnier, prestre de ce diocèse en a aussi pris possession canonique en sa qualité de gradué sur l’abbaye de Beaumont-en-Auge », fait réitérer ses noms et grades au seig r évêque de Lx.
394. — Le 22 nov. 1750, Louis Delauney, fils de François et de Marguerite Langlois, de la parr. de Pennedepie, reçoit la tonsure et les ordres mineurs.
153. — Le 6 sept. 1765, dispense de bans pour le mariage entre Meste Robert-Jacques-Alexandre ile Naguet, Escr, sr de St-Georges, officier au régiment d’Auvergne, fils de feu Alexandre et de feue dame Rose (juillet, demeurant à Pennedepie, d’une part, et damlle Thérèse Quillet, fille de Thomas-Etienne Quillet, trésorier de la marine de Honfleur, et de dame Marguerite-Victoire Capet, de la parr. Ste Catherine de Honfleur. Le même jour, Mr. Jean-Baptiste Le Rat, chanoine de la Cathédrale
et vice-gérant en l’ofiicialité de l’évêché, fulmine la dispense de parenté au 3e degré pour led. mariage.
Pennedepie (Saint Georges).
Curés. — M. -A. Audran— G. Tillard. — B. Lemonnier.
Prêtre desservant. — L. Lesueur.
Clerc. — L. Delauney.
Patron. —Les religieux de Beaumont. —Le roy, (ob litem).
Seigneurs. — A. de Naguet de Saint-Georges — R.-Jq A. de Naguet de Saint-Georges.
34. — Le 16 janv. 1781, dispense de bans pour le mariage entre Mesre Jean-Alexandre-Adrien de Cormeille, sr du Vieuxbourg, fils de Mesre Jean-Adrien de Cormeille, capitaine de canonniers, etc., et de feue noble dame Marie-Françoise-Charlotte de Costard, originaire de la parr, de Pennedepie et demeurant en celle du Vieux-Bourg, d’une part, et demlle Louise- Eugénie de Launey, Fille de M. Jacques-Charles de Launey, conser du roy, et de feue dame Catherine-Marguerite Gets (?), de la parr. St-Ouen de Pontaudemer.
M.Carpentier, né à Genneville en 1757. Il fut nommé en 1804 curé de Pennedepie. En 1819, il obtint un exeat pour aller dans le diocèse d’Evreux. Il mourut curé de la Chapelle-Gautier, le 29 déc.
1829, à l’âge de 72 ans. (Liste des pensionnés de Bernay en l’an III. — Archives -le Bx. — Ordo d’Evreux.)
Vicaire. — Jh -Ph. Le Monnier de la Haitrée
Seigneurs. — J.-A. de Cormeilles — Jq-A-A. de Cormeilles — A. de Naguet de St-Georges.
Annuaire des cinq départements de la Normandie.
Cette localité possédait, il y a plus de quatre siècles, un port, d’une importance, il est vrai, assez médiocre, car il n’en est question que dans un petit nombre de documents.
Ce fut cependant à Pennedepie qu’en juillet 1441 débarqua le duc d’York, à la tête des forces anglaises destinées à secourir Pontoise qu’assiégeait le roi Charles VII. Mais ce port ne subsistait déjà plus à la fin du même siècle.
L’aveu de Roncheville de 1522, déjà cité, nous apprend qu’à Pennedepie « il y avait «anciennement un hable sur la mer appartenant au vicomte, de présent en ruine, où il avait coustume des marchandises.» Les habitants du lieu étaient certainement adonnés à la navigation, car le même document porte que « les sujets de Pennedepie sont tenus de conduire le navire du seigneur dudit hable au prochain hable en la mer du chasteau de Bricquebec, et le ramener, si besoin est, toutes fois que plaira audit vicomte.
Il est curieux de constater l’existence d’un port qui n’a laissé aucun vestige et dont tout souvenir a disparu depuis plusieurs siècles.
Ce dont parlent plus volontiers les habitants de ce quartier, c’est d’une antique forêt qui aurait couvert leurs plages, et dont les débris sont souvent mis au jour, à mesure que la mer vient corroder le rivage.
Sans m’inscrire en faux contre une croyance appuyée sur des faits, je dois faire remarquer qu’aucun document ancien ne constate l’existence de cette forêt. Au moyen âge, cette côte était couverte de champs, de prés, d’enclos et de maisons.
S’il est certain que ce fertile et gracieux rivage a été couvert d’une épaisse forêt, ce peut bien être avant que l’homme civilisé n’eût paru dans nos contrées, peut-être même avant que les derniers bouleversements géologiques eussent donné à notre sol sa configuration actuelle.
VASOUY ET PENNEDEPIE. – Ces deux communes, bien qu’à des degrés différents, nous ayant offert des objets identiques, conduisant aux mêmes conclusions archéologiques, nous pensons qu’il convient de réunir dans une seule note les faits qui y sont relatifs.
A Vasouy et à Pennedepie, nous avons, en effet, découvert des stations de l’âge de la pierre taillée, des restes de l’âge de la pierre polie, et, enfin, un certain nombre d’objets remontant à l’époque gallo-romaine.
A l’exposition rétrospective, M. Le Compagnon avait une chaîne en or d’origine franque, venant de Pennedepie.
Essai historique sur Honfleur et l’arrondissement de Pont-l’Évêque – A. Labutte
A commune de Pennedepie possédait au XIIe siècle un couvent de templiers : l’église qui en faisait partie, et qui existe encore aujourd’hui, a été défigurée par de nombreux travaux de démolition et de reconstruction, qui l’ont réduite enfin à n’être qu’un édifice sans caractère.
Il y a quelques années que des fouilles conduites pour un but d’utilité privée , dans une cour qui servait de cimetière aux religieux , et qui porte encore le nom de Cour du cimetière, firent découvrir un énorme cercueil en pierre : on eut quelque peine à le briser : il contenait des restes humains parfaitement conservés, que tout fit présumer être ceux d’un templier. Au surplus, le cercueil ne portait les traces d’aucune inscription.
Rien autre chose à Pennedepie, qui réveille le souvenir de cet ordre célèbre, qui s’était voué à la défense des lieux où s’accomplirent les grandes scènes du christianisme ; rien autre chose, qui rappelle sa chute héroïque et cet ajournement solennel donné à un pape et à un roi par son chef vénérable, du haut de son bûcher ! Un tombeau retrouvé par hasard par un obscur ouvrier! un ancien champ de mort, dont l’antique dénomination a persisté à travers les siècles! voilà tout ce qui subsiste dans notre contrée de ce grand ordre religieux et militaire, qui remplit l’Europe du moyen-âge du bruit de ses exploits et de sa fin terrible et mystérieuse.
Recherche faite en 1540, par les élus de Lisieux des nobles de leur élection – Labbey de La Roque, Pierre Élie Marie.
PENNEDEPIE.
296. Les héritiers de Pierre Nollent n’ont été aucunement approchés , parce qu’il n’est notoire de leur demeure, et ne sçait-on s’ils sont en âge.
297. Louis Naguet a fourni avec son frere, en la ville de Honfleur, n°. 312.
Les Archives de la ville d’Honfleur.
1601 , 20 octobre. Aveu rendu à Henri de Bourbon duc de Montpensier, par Robert Bonfils pour deux pièces de terre assises dans la paroisse de Pennedepie et dépendant du domaine d’Auge.
1609, 6 août. Copied’un aveu rendu à Marie de Bourbon duchesse de Montpensier, par Pierre et Guillaume Bataille
pour une pièce de terre nommée la Brochette, dépendant du fiefdu Bièvre et située sur la paroisse de Pennedepie.
1609, 17 octobre. Copie d’un aveu rendu à Marie de Bourbon, par Robert Bonfils pour une pièce de terre dépendant du fief au Bièvre.
1645, septembre. Deux aveux rendus à Gaston d’Orléans, par Germain Cazier et Philippe Bonfils pour trois pièces de
terre assises à Pennedepie.
1652, 13 juillet. Aveu rendu à Mlle de Montpensier, par Hugues Morin, apothicaire, pour quatre pièces de terre
situées à Pennedepie et dépendantes du fief au Biefvre.
1675, 3 juillet. Aveu rendu à Mlle de Montpensier, par Germain Cazier pour une pièce de terre assise à Pennedepie et nommée les Pendants Martin.
FIEF DE MEAUTRIX – assis sur les paroisses de Barneville-la-Bertran, Pennedepie et Honfleur.
1453, 8 novembre. Copie d’un aveu rendu à Robert de Prestreval, écuyer, seigneur de Meautrix, par Jean Le Bouteiller pour le fief ou aînesse des Octons assis sur la paroisse de Pennedepie.
1476, 30 avril. Aveu rendu à Robert de Prestreval, par Pierre Cavelier pour un fief ou aînesse nommé le fief Pitres assis en la paroisse de Pennedepie et contenant onze acres.
1501 , 19 juin et 6 juillet . Deux aveux rendus à Guillaume Le Paulmier, écuyer, par Melaingne Augu, maître-ès-arts et prêtre de la paroisse de Pennedepie, pour l’aînesse Tuboeuf.
1551, 8 juillet. Aveu rendu à Charles Le Paulmier, par Marguerite veuve de Massé Pelé pour cinq perches de terre situées à Pennedepie et bornées d’un côté la ruette du Puchot tendante du hamel de Longueville à la grève .
1551, 8 juillet. Aveu rendu à Charles Le Paulmier, par Michel Courson pour quatre perches de terre situées à Pennedepie.
1551, 8 juillet. Aveu rendu à Etienne Le Paulmier, par Philippe et Louis Auzeree, fils de Richard Auzeree, pilote de navire, pour quatre pièces de terre situées à Pennedepie et faisant partie du fief Tuboeuf.
1600, 10 juillet. Aveu rendu à François Le Paulmier, par les enfants de de Louis Heurtelot pour une pièce de terre à Pennedepie.
1609, 13 juillet. Aveu rendu à François Le Paulmier, par Jacques et Guillaume dits Castel pour une pièce de terre et trois maisons situées à Pennedepie.
1623 , 19 juin . Aveu rendu à Avoye et Françoise Le Paulmier, par Simon Besongne, prêtre, curé de Pennedepie, pour une pièce de terre et une maison.
FIEF DE BLOSSEVILLE ET DE CRIQUEBEUF:
1600, 4 juillet. Copie d’un aveu rendu à Lancelot de la Garenne, par Philippe Bonfils pour deux pièces de terre situées à Pennedepie.
1606, 6 juillet. Aveu rendu à Lancelot de la Garenne, par Germain Boudard, greffier de l’hôtel communde la ville de Honfleur, pour une pièce de terre en labour nommée la Fossette, située à Pennedepie et faisant partie de l’aînesse ou fief de la Fauconnerie.
1620, 4 juillet. Copie d’un aveu rendu à Lancelot de la Garenne, par Steve Le Maistre pour une pièce de terre en labour, située à Pennedepie et nommée le Long Bovel.
1626, 2 et 3 juin. Deux aveux rendus à Robert Malet, écuyer, par Germain Boudard, tabellion et Geuffin Le Maistre pour cinq pièces de terre situées à Pennedepie et faisant partie de l’aînesse au Marmion dont est aîné et assembleur Me Jacques Auber, receveur des deniers.
1627-1628 . Six aveux rendus à Robert Malet, par Michel Mazaie, Jean Morin apothicaire et Jacqueline Bonfils pour plusieurs pièces de terre situées à Pennedepie et à Criquebeuf.
1652-1672. Douze aveux rendus à François Malet de Graville, chevalier, par Hugues Morin, Elie et Germain Cazier, Susanne Telles pour plusieurs pièces de terre situées à Pennedepie.
1685, 18 juin. Aveu rendu à François Malet de Graville, par Olivier Le Bouteiller pour une pièce de terre située à Pennedepie et nommée le Clos Léger.
1718, 30 mars. Deux aveux rendus à Abel-Toussaint de Thiville, chevalier, comte de Bapaulme, par Anne Malet, veuve de Pierre Heuzey pour une pièce de terre située à Pennedepie.
Almanach royal. 1745.
Chauffe-cire. Vata de Pennedepie, rue St-Martin, au coin de la rue Aumaire. près S. Nic. des Ch.- Boullay, Messager de la Grande Chancellerie et suite du Conseil, rue Montmartre, au-dessus de l’Hôtel de Charost.
Insinuations
L’église de Pennedepie a pour patron St Georges. Cette église bâtie sur un monticule à peu de distance de la mer domine un charmant vallon que traverse le chemin de moyenne communication de Honfleur à Trouville.
Au 14e siècle elle dépendait de la célèbre abbaye de St Ouen de Rouen. En Janvier 1400 dit Toussaint Duplessis (Description géographique et historique de la Haute Normandie 1740) l’abbé et les religieux de St Ouen arrêtèrent entre eux qu’ils présenteraient conjointement aux bénéfices de leur dépendance à la réserve de ceux qui composaient l’exemption du monastère auxquels l’abbé seul pourvoirait de plein droit.
Aux 16e et 18e siècle, le patronage appartenait au seigneur.
Avant la Révolution, le présentateur à la cure était le prieur de Beaumont en Auge( Alùanach de Lisieux pour l’année 1774)
Suit la description de l’église.
Monsieur Labutte dans son Essai historique sur Honfleur et l’arrondissement de Pont l’Evêque nous apprend qu’il existait à Pennedepie au 12e siècle un couvent de Templiers. On sait que cet ordre célèbre fondé à Jérusalem en 1118 par Hugues de Payens de la Maison des Comtes de Champagne, fut supprimé en 1312 par le Pape Clément V dans un consistoire secret tenu à Vienne en Dauphiné. La plus grande partie des biens des Templiers fut donnée aux Chevaliers de St Jean de Jérusalem, l’autre partie rentra dans le domaine de l’Etat ou passa en mains séculières.
Il y a quelques années des fouilles conduites pour un but d’utilité privée, dans une cour qui servait de cimetière aux religieux et qui porte encore le nom de Cour du Cimetière, firent découvrir un énorme cercueil en pierre contenant des restes humains parfaitement conservés, que tout fit présumer être ceux d’un templier. Le cercueil ne portait trace d’aucune inscription.
Au fond d’un vallon coule un ruisseau qui fait mouvoir un ancien moulin dont la construction remonte au 16e siècle. Le rez-de-chaussée, bâti en travertin et surmonté d’un étage en charpente avec tuiles entre les colombages. Une jolie lucarne en bois a deux baies cintrées fait saillie sur le toit.
La commune de Vasouy a été annexée pour le culte à celle de Pennedepie. (A.Pannier)
Deuxième description de l’église du 12 septembre 1868.
3 – Archives ShL:
Cartulaire Shl avec inventaires ShL et sources bibliographiques diverses du Xe siècle à 1940 :
1195. Robert Bertran donne à son sergent, Herbert de Barneville, cinq acres de terre dans son domaine de Titot, et
une acre de pré à Pennedepie (comm. de Honfleur). (n° 48.)
1312 p. 52. (165) De la prévosté de Pennedepie, pour tout l’an…. C s. (La fieffe de cette prévôté est sans variation de 1266 à 1461 (Strayer, p. 219). En 1461, elle est au seigneur de la Rocheguyon et de Roncheville au nom de la dame de Rais, comme successeurs de Robert Bertran, chevalier. L’année suivante, elle est tenue par Michel d’Estouteville, chevalier, à cause de sa femme Marie de la Rocheguyon et en 1476 par Bertin de Silly, second mari de cette dame.).
= Henri de FRONDEVILLE, Le Compte de Gautier du Bois, vicomte d’Auge pour la Saint-Michel 1312 in Mélanges publiés par la Société de l’Histoire de Normandie, 15e série, p. 35.
1F468 : 17 février 1706 : Delamorinière de Pennedepie a fieffé une rente foncière à Thomas Letailleur passementier à Lisieux.
A noter dans :Le vieux Honfleur et ses marins, biographies et récits militaires par Ch. Bréard: Le capitaine de vaisseau Siméon est décédé le 5 avril 1820, à Plabennec (Finistère). Il avait épousé, en 1774, Anne-Catherine Delamorinière, née à Pennedepie, en 1752. De cette union, il laissa plusieurs enfants, parmi lesquels nous citerons Jean-Louis-Étienne Siméon, né à Honfleur, le 26 décembre 1777, qui suivit la même carrière que son père et fut nommé lieutenant de vaisseau en 1811.
Carnets de Charles VASSEUR .
DOYENNE DE HONFLEUR – 14
Sous l’invocation de St Georges
Patronage: 14e, 16e et 18e siècle: Abbas S. Andoeni Rothomagenisi
Curé: Le Monnier 1756/1787
Fonds Manuscrits.
790. Trois pièces. Gages-pleiges de la seigneurie de Blosseville, Pennedepie; 1635; 1647; 1669.
Fonds Erudits NE 09 MOISY Alexandre.
Sommaire des Carnets d’Alexandre MOISY
ARCHEOLOGIE – 2 – Vasouy et Pennedepie.
1221. Robert Bertran confirme à l’abbaye Saint-Ouen de Rouen les donations que Robert le Tort et Suzanne, femme de celui-ci, avaient faites pour doter le prieuré de Notre-Dame-de-Beaumont-en-Auge…et in prefectura de Ronchevilla (Roncheville) quadraginta solidos, et in censibus de Penna Pice (Pennedepie) decem solidos, et in prefectura de Honeflue (Honfleur) =¸ EDIT. Charles BREARD, Cartulaire de la baronnie de Bricquebec, n°19, pp. 205-207 + IND. AD 76 14 H 797 (1680).
Carnets de Charles Vasseur :
EXTRAIT DE NOTES RECUEILLEES PAR MONSIEUR CATHERINE, INSTITUTEUR A GONNEVILLE SUR HONFLEUR.
Robert Bertrand, baron de Roncheville et de Briquebec, avait donné en 1221 au prieuré de Beaumont, le tiers de la dîme des quatre fiefs qui relevaient de la baronnie de Roncheville dans les communes de Pennedepie et de Barneville. Ces fiefs étaient Pennedepie, Blosville, Meautrix et Bouttemont et dans une nouvelle charte de 1255 revenant sur ce qu’il avait précédemment accordé il donna aux religieux la totalité de la dîme sur les quatre fiefs.
Fonds Erudits NE 26 NEDELEC Yves Communes.
Com.60.3.1 Pennedepie Duc de Composelice
Com.60.3.2 Pennedepie Le sourire de Pennedepie
Com.60.3.3 Pennedepie Famille de Polignac
Com.60.3.4 Pennedepie Eglise
Com.60.3.5 Pennedepie Notes historiques
Com.60.3.6 Pennedepie Curés
Com.60.3.7 Pennedepie Famile Le Jumel
Com.60.3.8 Pennedepie Vie de la commune 1991-2007

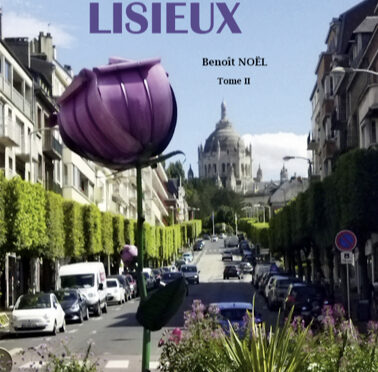
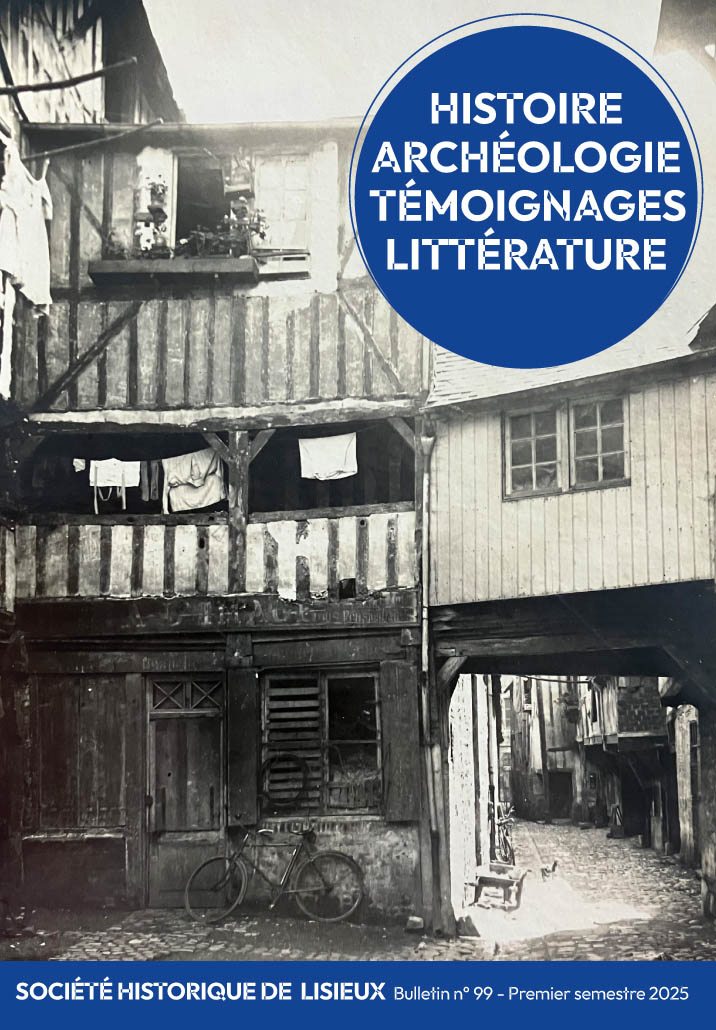
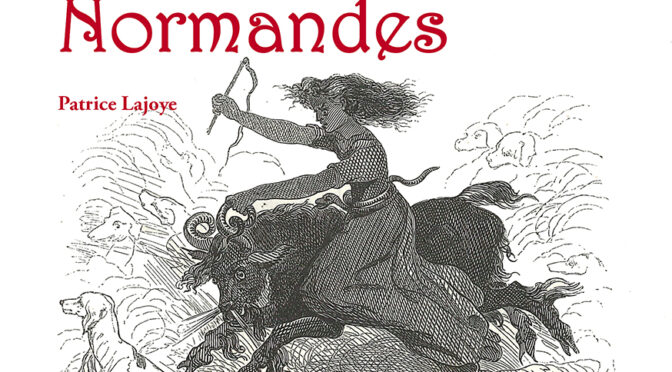
Laisser un commentaire