NOTES sur Le Mesnil-Guillaume Le
Mesnillus .Guillelmi
Le Mesnil-Guillaume (Calvados)
Canton actuel : Lisieux
Arrondissement actuel :Lisieux
Code INSEE : 14421
MESNIL-GUILLAUME
I. Dioc . de Lisieux. Baill. d’Orbec.- Maîtrise d’Argentan . Gr.à sel de Lisieux. –
Gén. et int. d’Alençon; él. et subd. de Lisieux.
II. Distr. de Lisieux; canton de Courtonne-la- Ville (Arrêté du 1er mars 1790).
III. 4 arr. communal (Arr. de Lisieux); canton de Courtonne-la-Ville (Loi du 28 pluviôse an VIII). — canton de Lisieux. ( 1° section) (Arrêté du 6 brumaire an X). Pop.: 285-273 hab. (1911) . Sup.: 385 hect. 50 a. 54 c.
ADMO Gale . – Délibérations .24 septembre 1788-10 germinal an VI (4 reg., 141 fol.; 2 reg., fol. 1-82).
Reprise des délibérations: 18 frimaire an IX.
ÉTAT-CIVIL. Baptêmes, depuis 1607.- Mariages et sépultures, depuis 1623. Lacunes: 1672-1673.
IMPOSITIONS. États de sections ( Sections A- B). An V (2 cah., 102 fol. )
Voir aux Archives du Calvados les délibérations du Comité de surveillance de Mesnil-Guillaume 21 octobre 1793-10 vendémiaire an III ( Reg.et 1 p. )
1 – Bibliographie.
2 – Historique.
3 – Description du Château.
4 – Pièces justificatives
5 – Archives ShL.
1 – BIBLIOGRAPHIE
Jean BUREAU.- » De Manoirs en Châteaux ou l’excursion de printemps », PA, 12, N° 6, Juin 1962, pp. 1-4 Mesnil-Guillaume.
Arcisse de CAUMONT, Statistique monumentale du Calvados [26], t. V, pp. 155-162
Comte de COLBERT-LAPLACE, » Souvenirs du Comte de Colbert-Laplace sur Mesnil-Guillaume et le Pays d’Auge », PA, 6, N°12, Décembre 1956, pp. 8-10. prend la défense de Charles Humbert
Etienne DEVILLE, » Excursion du 26 août (1926) », AAN, 94, 1927, pp. 148-171.
Editions Flohic : Le patrimoine des communes du Pays d’Auge page 1052.
Paul HIRTZ et Jacques DEROUARD, » En Pays d’Auge… excursion », Centre havrais de recherches historiques, bull.,n° 28, sept. 1989, pp. 5-8 = Châteaux de Mesnil-Guillaume.
Paul LE CACHEUX.- Actes de la chancellerie d’Henri VI concernant la Normandie sous la domination anglaise (1422-1435), Rouen-Paris, Lestringant-Picard, 1907, 2 vol., In-8°.; Mesnil-Guillaume, I, 15; Guillaume de Trousseauville, I, 160; Jean et Guillaume, II, 353; Jean de, II, 372.
Auguste LE PREVOST, Mémoires et notes… pour servir à l’histoire du département de l’Eure, Evreux, Hérissey, 1862-1869-1869. In-8°, XXXV-576, 632, 582
Yves LESCROART, La Renaissance en Pays d’Auge dans La Renaissance en Basse-Normandie, numéro spécial de Art de Basse-Normandie, Printemps 1975, pp. 54-68
N° 351-352. » La forteresse de Mesnil-Guillaume, ruinée à la fin du XVe siècle, sous Guillaume de Trousseauville, fut reconstruite par les Le Vallois.
Charles NODIER, J. TAYLOR et Alph. DE CAILLEUX.- Voyages pittoresques et romantiques dans l’Ancienne France par…. Paris, Firmin-Didot, 1820 ; rééd. 1825; rééd. Paris, Firmin-Didot et Cie, 1878;
PAUMIER Henri : Pour l’histoire du papier. Les moulins des papetiers du Pays d’Auge. Bulletin du Foyer rural du Billot, n°82, juin 2003.
Henri PELLERIN, » Le Château de Mesnil-Guillaume », PA, 6, N° 7, Juillet 1956, pp. 1-7, ill.
Louis RIOULT de NEUVILLE, Le Château de Mesnil-Guillaume in La Normandie Monumentale et Pittoresque, Le Havre, Le Male et Cie., réédit. Corlet, t. II, pp. 125-127
Louis RIOULT de NEUVILLE, Généalogie de la famille de Rioult avec les preuves à l’appui, Besançon, Joseph Jacques, 1911, in-8°, 90 p.; pp. 50-51.
Henri VUAGNEUX, A travers le Pays d’Auge, Paris, Dentu, 1889, In-8°, 243 p.
papeteries:
Mesnil-Guillaume: Nicollas Bonhomme, 26 janvier 1581
Revue Le Pays d’Auge.
Y. Lucas Mesnil-Guillaume 1956-07-juil.
2 – HISTORIQUE :
Au début du XIVe siècle, il semblerait que la seigneurie de Mesnil-Guillaume [1] ait déjà été démembrée, puisque nous voyons apparaître dans la liste des fiefs de la vicomté d’Orbec, un quart de fief relevant directement du Roi, tenu par Guyot de Moyad qui est également patron de l’église [2].
Une trentaine d’années plus tard, vers 1350 [3], le patronage de cette paroisse appartient à Robert de Morsan, qui selon Auguste Le Prévost [4] serait le fils de Jean de Brionne [5], seigneur de Morsan qui paraît dans le Pouillé du diocèse de Lisieux comme patron d’Hermival ».[6] .
Dès le XVe siècle nous y trouvons la famille de Trousseauville dont un représentant, Guillaume[7], capitaine de Lisieux, est qualifié par Thomas Basin de » brave chevalier [8]. bien représentée dans le Lieuvin: à Morainville [9], à Giverville, à Epreville-en-Lieuvin et à Duranville [10]
En 1444, » les enfants soubagiés et hoirs de feu Henry de Trousseauville, en son vivant escuier, venus en la garde du Roy nostre sire pour leur minorité d’âge par le trépas de leursdis père mère, par damoiselle Marguerite de Tournebeuf, mère desdits soubagiés, iiij L. ij s. t. dont lxj s. vj d. t. à la recepte de ceste viconté et xx s. vj d. t. à la recepte de la viconté de Verneuil aux terùmes de Pasques et saint Michel, pour moictié.
Pour ce, à ce terme pour moictié par ladite damoiselle…. xxx s. ix d. »
En 1454, un Guillaume de Trousseauville, sans doute l’un des fils de Henry, fieffe de l’évêque de Lisieux, une pièce de terre assise à Glos [11] et si nous suivons H. PELLERIN [12], ce serait ce Guillaume de Trousseauville qui aurait vendu cette terre aux Le Vallois.
La famille Le Valloys [13] était sans doute lexovienne, à moins qu’il ne faille recherche ses premières origines autour de Sait-Germain-la-Campagne. La première mention la concernant, relevée par JOUGLA de MORENAS, remonte aux premières années du XV° siècle[14], mais localement la plus ancienne trace connue remonte seulement à 1452 où nous voyons paraître un GUILLAUME le VALLOIS, bourgeois de Lisieux » Conseiller de Ville » [15], charge qu’il occupe encore le 9 janvier 1483. Nous le trouvons ensuite en 146O à la faveur d’une constitution de rente en faveur de Perrin Hamel dont, dix ans plus tard, Me Jehan Trotin fera le franchissement. Dès cet instant, l’on entrevoit ce qui longtemps restera les deux grandes activités des Le Valloys, le prêt d’argent [16] sous sa forme déguisée de la constitution de rentes [17] et le » trafic » des propriétés.
En 1469, Guillaume Le Valloys habitait [18] Grande-Rue (au N° 55 de la numérotation antérieure à la destruction de 1944) au fond de l’allée [19] un hôtel portant le nom de cette famille.
Son fils Colin ou Nicolas, bourgeois de Lisieux, lui succède dans le charge de Conseiller et, le corps de ville le nomme leur » procureur général et certain messager especial afin d’obtenir de la court du Roy notre sire lectres de confirmation, continuation ou prolongement du droit de marchant pour fournir le grenier à sel de cested. ville ». En quelques années, il se rendit acquéreur de Mesnil-Guillaume, de Putot, de Bonneville, et de la Rosiere et dès 1501 il paraît dans un contrat comme » honorable » seigneur de la Rozière.
En 1516, lors du partage de sa succession par sa veuve Guillemette Dupont entre ses trois fils, Jean, l’aîné, figure comme seigneur de Mesnil-Guillaume.
Puis ce fut le lot de Nicolas II, sieur d’Escoville, qui avait épousé Catherine Hennequin dont il n’eut pas d’enfant. Il convola une seconde fois avec Marie Du Val de Mondrainville. Il mourut en 1542. De sa seconde union, il avait eut quatre fils et deux filles: Louis, qui hérita de Fontaine-Etoupefour, François, qui devint seigneur d’Escoville; à Nicolas échut Manneville tandis que sa fille aînée Anne épousait Jacques Le Fournier et la cadette, Marguerite épousait Geoffroi du Mont.
Son troisième fils, Jean II, hérita de Mesnil-Guillaume avec la seigneurie du Coq et c’est sans doute à lui qu’il faut attribuer l’édification du château tel qu’il se présente actuellement.
De son mariage avec Louise de La Valette, il eut trois filles, dont l’aînée Marie devint dame de Mesnil-Guillaume. Elle se maria à Charles Le Gouez, sieur du Parc et de Manneville dont on trouve encore la trace en 1613 et 1617.
Une pénible affaire de meurtre commis par Louis Le Gouez et deux de ses fils, contraignit le troisième à abandonner la seigneurie de Mesnil-Guillaume.
Au début du XVIIIe siècle elle se trouvait dans la famille de Mailloc, mais à partir du XVIIe siècle, l’histoire des familles ne nous intéresse plus, les derniers travaux étant achevés et il nous est parvenu dans l’ensemble tel qu’il était après les grands travaux du XVIIe siècle.
3 – DESCRIPTION du Château.
Plus heureux qu’en beaucoup d’autres cas, nous avons la chance de posséder trois descriptions anciennes fiables et quelques gravures qui nous permettent de restituer son état au siècle dernier et de suivre avec une certaine précision les diverses transformations subies par ce château au cours du dernier siècle.
Malheureusement, nous ne possédons aucune analyse ancienne des distributions intérieures et si, l’extérieur n’a pas subi de transformations indécelables, en revanche, l’intérieur paraît avoir été profondément bouleversé en beaucoup d’endroits.
Certains auteurs [20] ont laissé à entendre qu’il existait autrefois, en ce lieu, une forteresse, ruinée à la fin du XVe siècle. Le peu d’importance du fief – il ne s’agit que d’un quart de fief nous rend sceptique à ce sujet. Nous pensons qu’il pouvait tout au plus s’y trouver, et sans doute jusqu’au troisième quart du XVIe siècle, comme en beaucoup d’autres cas de seigneuries secondaires, un manoir, habitation habituelle des seigneurs de second rang. Si le fief revêt une certaine importance pour les premières générations des Le Valloys, à partir de Nicolas II, ce domaine sera le lot du troisième fils seulement.
Situation
Le château est assis dans un site grandiose, au fond de la vallée d’Orbiquet, entouré de frondaisons séculaires.
La proximité de la rivière devait permettre en mise en eau facile de ce site qui, très anciennement sans doute, comme la plupart des fiefs secondaires, était entouré d’un fossé quadrangulaire.
Plan
Le château présente actuellement un bâtiment de plan rectangulaire, orienté Nord-Sud, formé de quatre corps cantonnés au Sud de deux tourelles rondes sur colonne et au Nord de deux tourelles pentagonales montant de fond.
Au milieu de la façade principale regardant au Sud s’élève un pavillon central faisant saillie, percé d’un passage à cheval donnant accès à la cour intérieure. C’était autrefois la seule entrée à ce château avant qu’une transformation, sans doute assez tardive, ait largement ouvert le flanc Nord vers Lisieux, permettant ainsi d’accéder à un large perron, enjambant le fossé, accompagné d’un escalier en fer à cheval.
Logis de bois
Extérieurement, l’on remarque, au Nord du mur gouttereau Ouest, un léger décrochement qui correspond en partie à la construction de bois antérieure, bien visible de la cour intérieure. Le fait qu’il n’y ait pas correspondance exacte entre ce décrochement et la longueur du corps de logis en bois visible de la cour, peut laisser à supposer que la façade de cette oeuvre de charpenterie a été modifiée et allongée. Nous trouvons en effet devant un schéma bien circonscrit maintenant de constructions de bois des XVe ou XVIe siècles habillées d’une chemise de pierre à la fin du XVIe siècle ou au siècle suivant [21] tels les châteaux de Cricqueville, du Pontif, à Coquainvillers ou de Belleau-Belleau, à Notre-Dame-de-Courson.
En ce qui concerne la façade sur cour, Louis Rioult de Neuville voulait y voir une oeuvre de l’époque Louis XII ou du règne de François Ier tandis qu’Henri Pellerin la datait de la fin du XVIe siècle, rattachant le lion hissant sculpté dans un cartouche, aux armoiries de Louise de La Valette [22]
Vue de la cour intérieure, la façade Ouest présente un soubassement de brique et un étage de pan de bois. Le rez-de-chaussée, avec ses encadrements de porte et de fenêtres de pierre se rattache à une campagne de reprise en sous-œuvre de l’étage qui remonte semble-t-il au milieu du XVIIe siècle. Au-dessus, nous trouvons une façade en pan de bois de sept travées. Les colombes étroites sont moulurées et sculptées de pilastres avec chapiteaux ou de cariatides, selon un modèle courant dans la charpenterie lexovienne du troisième quart du XVIe siècle [23]. A l’origine, celui-ci était percé d’une succession d’ouvertures limitées en partie basses par une lisse d’appui moulurée et sculptée de godrons, identique à celles que nous rencontrons à Orbec, au Verger à Fervaques, à Vimoutiers, etc.
Certaines ouvertures d’étages, à l’occasion sans doute de la reprise en sous-œuvre, furent agrandies, faisant descendre la traverse d’allège en dessous de la lisse moulurée, tandis que d’autres étaient occultées, modifiant ainsi totalement l’ordonnance des colombages. Relevons que l’entre colombage était garni de briquettes à tenons [24] parti identique à celui utilisé dans le manoir voisin de Querville.
Les photographies anciennes qui nous sont parvenues de cet état, permettent de mesurer l’ampleur des dégâts, difficilement imaginables maintenant qu’une bonne restauration a redonné à cette façade, sinon son rythme d’origine, tout au moins une partie de ses dispositions anciennes.
Bâtiments de pierre
L’intérêt majeur de Mesnil-Guillaume, au-delà de la qualité de son parc, réside dans son homogénéité. En-dehors du petit bâtiment de bois que nous venons de décrire et qui est invisible de l’extérieur, l’ensemble de la construction fut élevé en une seule campagne ce qui lui confère une unité rarement rencontrée ailleurs. En effet, la majeure partie de ces grands châteaux transformés ou élevés aux XVIe et au XVIIe siècle sur un plan fermé ont été amputés de deux ou trois des corps entourant la cour. C’est le cas entre autres pour le château de Saint-Germain-de-Livet, le manoir du Bois du Bais à Cambremer, le château de Fervaques, le château de Bouttemont à Ouilly-le-Vicomte etc. Ici, comme à Ouilly du Houlley, Querville à Prêtreville ou – jusqu’à une date récente – au manoir de Glatigny, à Tourgéville, les quatre faces ont été préservées. Tout au plus, peut-on regretter que la totalité des lucarnes qui surplombaient les murs et dont la trace subsiste dans l’interruption et les retours de corniche, aient disparu. Une rapide restitution de l’état antérieur – celui que l’on peut encore admirer au château d’Ouilly-du-Houlley – permet de mieux juger de l’élégance extraordinaire que présentait alors l’ensemble.
Tourelles
Ces bâtiments, nous l’avons dit sont cantonnés de quatre tourelles qui, par l’emploi conjoint de la pierre utilisée en harpes verticales et de la brique, introduisent une note colorée rompant la monotonie des grandes surfaces de pierre. Il s’en dégage beaucoup de charme, autant par leur variété que par leurs proportions ou leur plan. Deux d’entre elles, sur la façade Sud sont rondes et suspendues – celle de l’Ouest, quant à elle, repose sur une délicate colonne à fût carré moulurée – donnent à cette façade une certaine élévation. Les deux plus lointaines, vers les Nord, montent de fond et sont construites sur un plan bastionné [25], qui par une illusion de perspective audacieuse leur confère une importance qui tranche, lorsqu’on les regarde sur l’angle, avec une grande légèreté. Toutes ces tourelles sont recouvertes d’un comble à la Philibert De L’Orme et ceux des tourelles bastionnées sont des chef-d’œuvres de charpente.
Portail
Le pavillon du portail se rattache à un modèle courant en Pays d’AUge et mériterait une étude approfondie pour restituer son état d’origine qui devait s’identifier à celui du château de Bouttemont à Ouilly-le-Vicomte.
En résumé, ce monument est l’un des plus remarquables par son unité de ceux qui furent élevés à l’extrême fin du XVIe siècle ou dans les premières années du XVIIe. L’architecte auquel nous devons cette oeuvre sut parfaitement intégrer ce château dans un environnement sans doute très différent de l’actuel, mais, en artiste maîtrisant bien les volumes a évité à la fois la platitude et la lourdeur. Les similitudes dans les détails avec d’autres monuments tels le château de Fervaques – bien daté et dont l’architecte, Jacques Gabriel, nous est connu – le Palais épiscopal de Lisieux (façade sur la Place Thiers), Fumichon, Ouilly-du-Houlley, etc., doivent nous inciter à pousser des études pour retrouver le nom de l’auteur talentueux de toutes ces oeuvres qui ont largement et longtemps fait école dans la région.
Michel Cottin
Juillet 1992.
4 – Pieces Justificatives
Statistique Monumentale Du Calvados Par Arcisse De Caumont.
Notes de M. Ch. Vasseur.
Mesnil – Guillaume.
Mesnil-Guillaume, Mesnillus .Guillelmi,
L’église du Mesnil-Guillaume n’est point orientée selon l’usage : son chevet est à peu près en regard du nord-est.
Elle est cependant fort ancienne; on distingue parfaitement dans les murs l’appareil en feuilles de fougère, entremêlé de ces longues briques que l’on a déjà vues à Fierville, à Ouillie-le-Vicomte; elles sont disposées, comme dans cette dernière église, par chaînes horizontales, ou bien elles s’inclinent pour former l’opus spicalum, ou encore elles remplacent la pierre de taille, si rare dans la contrée, en garnissant les angles de la nef.
On remarque, sur le plan, qu’il y a absence complète de contreforts dans l’édifice.
On ne retrouve aucune ouverture de l’époque primitive : toutes ont été repercées à la fin du XVe. siècle, et la plupart ont subi des mutilations postérieurement. il n’en reste plus que deux qui aient un caractère archilectonique : ce sont les deux grandes fenêtres à meneau du côté de l’évangile; elles sont identiques.
La nef, qui avait primitivement 45 pieds de long, a été prolongée d’une travée vers 1852 ou 1853, Cette adjonction, dirigée, je crois, par un agent-voyer, n’a rien d’architectural.
En 1856, on a transporté le clocher sur cette partie. Il se trouvait autrefois assis sur l’arc triomphal, ainsi qu’on le constate dans les plus anciennes églises. Cette pérégrination lui a été fatale. Il datait du XVI. siècle ; sa charpente était revêtue d’essente, et la base était munie d’un double évent ou abatsons composé d’une série de petites ouvertures trilobées.
L’ardoise vulgaire a remplacé l’essente, et les trilobes des évents ont disparu.
Le choeur fait retraite sur la nef, il est petit; son chevet primitif a complètement disparu par suite, de l’érection d’une sacristie à pans coupés qui fait le prolongement des murs latéraux.
Celte sacristie est antérieure à la Révolution. Le mobilier est de nulle valeur artistique. On peut citer cependant une statue de saint Hildevert, évêque, qui date du moyen-âge. Les autels sont encore enveloppés de leurs parements de vieille soie.
La voûte en carène de la nef a vu disparaître ses poutres apparentes depuis la première visite que j’avais faite en 1853; on a toutefois respecté sa forme, qui offre un profil harmonieux et bien accentué. Ses sablières sont appuyées partie sur les murs, partie sur de fort singuliers corbeaux en pierre.
Quelle raison a pu engager à surmonter ces consoles, si bien moulurées, par la pierre brute qui se trouve immédiatement sous la poutre ?
La voûte du choeur est recouverte d’une épaisse couche de plâtre.
L’arc triomphal est ogival, garni de moulures prismatiques qui viennent reposer sur deux colonnes semi-cylindriques.
Ces caractères indiquent assez le XVe. siècle.
Dans le tympan d’une des deux fenêtres dont nous avons parlé, se trouve un blason.
Le pavage a conservé quelques reste.. bien frustes de carreaux émaillés.
L’église est sous l’invocation de Notre-Dame. Elle dépendait du doyenné d’Orbec et de la sergenterie de Moyaux. Le patronage était laïque et appartenait au seigneur du lieu.
La paroisse comptait 76 feux (380 habitants); elle en possède actuellement 404(?).
Le château est important et remarquable. Le dessin de M. Bouet fait voir la régularité de son ordonnance et son caractère architectonique, il est situé à une distance assez grande de l’église, du côté de la ville. Il est impossible d’en donner une meilleure description que les lignes que lui a consacrées M. Raymond Bordeaux dans son Excursion archéologique dans la vallée d’Orbec en 1850 :
« Mesnil-Guillaume, dit-il, est un château formé de quatre corps de logis, avec une cour carrée au milieu comme beaucoup d’autres habitations seigneuriales de l’époque d’Henri IV et de Louis XIII. L’architecture, mélangée de briques et de pierres, produit un effet harmonieux. En entrant dans l ‘intérieur de la cour, la façade du corps de logis de gauche est bâtie en bois et d’un style plus ancien. Les colombages verticaux sont chargés d’ornements dans le goût de ceux des maisons des XVe. et XVF. siècles qu’on remarque à Lisieux
[Cette partie est bien certainement un reste d’un château antérieur. Elle comprend sept travées de piastres d’ordre classique, déterminées par des pièces de bois d’un équarrissage beaucoup plus considérable, sculptées de ces larges feuillages à la mode sous le règne de François Ier. Mais, quand on a refait le rez-de-chaussée qui est en briques et les autres corps de logis, on s’est efforcé de moderniser cette bâtisse surannée. Les fenêtres ont été élargies et surélevées et on les a entourées de moulures qui accusent le règne de Louis XIII. La grande filière godronnée qui séparait les deux ordres de pilastres a dû suivre les contours des nouvelles baies, ce qui la fait onduler comme un crénelage. Enfin, on a mis sous la corniche de gros modillons en bois, dûmentre couverts de plâtre.]
Chemin faisant, dans les corridors, j’apercevais, mélangés aux vulgaires pavés de nos jours, quelques carreaux faïencés qui avaient assurément servi autrefois à composer de brillantes rosaces dans les chambres de ce château. Mais, vérification faite, c’étaient les mêmes types que nous avions déjà rencontrés à Beuvillers et à Mailloc, et cela me parut une preuve que ces pavés avaient été décorés dans les fabriques de poteries, si nombreuses aux environs de Lisieux.
La seigneurie du Mesnil-Guillaume appartenait, au XVIe. siècle, à une famille d’origine lexovienne, illustrée par de grandes alliances et par la construction de monuments importants. Nicolas Le Vallois, seigneur d’Escoville, qui a fait bâtir à Caen ce magnifique hôtel du XVI ». siècle, au jourd’hui la Bourse et le Tribunal de commerce, et qui possédait le château de Fontaine-Étoupefour près Caen , était en même temps seigneur du Mesnil-Guillaume. La famille Le Vallois jouait, à Caen, un très-grand rôle au XVIe. siècle, et à Bayeux au XVIII. Un mémoire manuscrit qui existe à la Bibliothèque de Caen, et dont l’auteur anonyme passe malignement en revue l’extraction de toutes les familles caennaises qu’on regardait alors comme nouvelles, indique celle-ci comme issue d’un simple artisan de Lisieux, enrichi dans le commerce.- Quoique les assertions de ce mémoire ne paraissent devoir être acceptées qu’avec beaucoup de réserve, les monuments viennent cependant confirmer ce fait, passé sous silence par les généalogistes, que les Le Vallois sont réellement originaires de Lisieux. Mais ils avaient tort de cacher cette origine, honorable pour le commerce lexovien, car leur famille devait être déjà fort distinguée dans cette ville à la fin du XVI. siècle. Nous avons, en effet, retrouvé leur écusson sculpté aux clefs de voûte de la nef de l’église St.-Jacques, élevée vers 1520.
Quoi qu’il en soit, j’ai cherché en vain dans le manoir de Mesnil-Guillaume l’écusson des Le Vallois. A l’intérieur de la cour, sur cette façade de charpente qui est d’un siècle environ plus ancienne que le reste des constructions, il y a, à la vérité, des armoiries; mais ce ne sont point celles de cette famille. Pourtant, tout fait croire que c’est à elle que le Mesnil-Guillaume doit la construction de ce château, d’un si bon effet dans la vallée. »
J’ajouterai à ces détails la description des magnifiques épis en terre émaillée qui terminaient autrefois les tourelles et les pignons des combles. On vient d’en retrouver les nombreuses pièces dans un coin de grenier ; M. R. Bordeaux n’avait donc pu les voir. La plupart avaient au moins 5 pieds d’élévation ; leur exécution, leur émail peuvent les faire regarder comme des plus remarquables. On y retrouve les têtes à coquilles, les pentes de fruits et de fleurs, et ces grandes branches de lis de jardin gracieusement recourbées dont se composent les plus belles pièces connues de ce genre. Un dessin peut seul faire deviner leur importance et leur mérite. Il y avait aussi quelques pièces de fabrication plus grossière, avec une simple couverte de couleur verte. On les avait arrachées des toits pour satisfaire au niveau égalitaire républicain, et aussi à cause des fleurs de lis, symbole aristocratique.
A la fin du XVI. siècle, la terre du Mesnil-Guillaume appartenait à Guillaume de Trousseauville, chevalier, qui était également seigneur de Giverville et de Morainville, en Lieuvin.
Ensuite, comme on l’a vu plus haut, on en trouve en possession la famille Le Valois. Nicolas Le Valois, qui avait épousé, en 1534, Marie du Val, veuve de Nicolas de Grandrue, étant mort en 1541 à l’âge de 47 ans, de la façon que raconte De Bras, ses biens furent partagés entre ses quatre fils qui firent tous branche. Le troisième, nommé Jean, fut seigneur du Mesnil-Guillaume et de Coq. Sa postérité ne s’éteignit qu’au commencement du XVIII. siècle, dans la personne de noble damoiselle Marie Le Valois, veuve de feu Charles Le Goys, vivant écuyer, sieur du Parc et de Manneville, dame du fief noble, terre et sieurie du Mesnil-Guillaume, qui vivait encore en 1613 et 1617, suivant des aveux et actes originaux où je l’ai trouvée mentionnée.
En 1709, suivant d’autres actes , la terre était passée à la famille de Mailloc ; car on trouve « messire François de Mailloc, chevalier, seigneur d’Estouteville, Mesnil-Guillaume et autres terres et seigneuries, demeurant ordinairement en son chasteau du Mesnil-Guillaume.
Le Chapitre de Lisieux possédait, sur le territoire de cette paroisse, une terre noble, nommée le Fief-aux Hues, que j’ai trouvée mentionnée dans un acte original de 1557.
Inventaire historique des actes transcrits aux insinuations ecclésiastiques de l’ancien Diocèse de Lisieux – PIEL L.F.D.
253. – Le 22 févr. 1700, vu l’attestation du sr Moëssard, curé du Mesnil-Guillaume, et du sr Cornu, vicaire de Moyaux, dispense de bans pour le mariage entre Gabriel Thillaye et Françoise Vallée.
287. -Le 22 mars 1704, Gabriel Thillaye, fils de Thomas et d’Anne Hoguais, de la parr, du Mesnil-Guillaume, reçoit la tonsure et les ordres mineurs.
422. – Le 20 janvier 1705, vu l’attestation du sr Morin, curé de St-Germain de Lx, du sr Moëssard, curé du Mesnil-Guillaume, et du sr Cordouen, curé de Hazoques, dispense de bans pour le mariage entre François de Mailloc, Esc, sr d’Estouteville, seig et patron du Mesnil-Guillaume, fils de feu Yves de Mailloc, Esc, seig d’Estouteville, en son vivant lieutenant de nos seigrs les Maréchaux de France, et de feue noble dame Charlotte Morin, demeurant au Mesnil-Guillaume, d’une part, et damlle Françoise-Elisabeth de Livet, fille de Jacques de Livet, Esc-, seigr de Barville, et de noble dame Marthe-Françoise Le Cornu, de la parr, de Bazoques.
545. – Le 7 juillet 1704, Jean Thillaye, marchand, demeurant au Mesnil-Guillaume, constitue 150 livres de rente en faveur de son frère, Me Gabriel Thillaye, acolyte, afin qu’il puisse parvenir aux ordres sacrés. Fait en présence de Me Louis Moissard, pbrë, curé du Mesnil-Guillaume.
334. – Le 12oct. 1704, Claude Leliquerre, fils de Louis et de Françoise Le Camus, de la parr, du Mesnil-Guillaume, reçoit la tonsure et les ordres mineurs. Ordonné sous-diacre le 7 avril 1708.
Le Mesnil-Guillaume
Curés. – L. Moissard.
Clercs. – G. Thillaye – C. Leliquerre.
Seigneurs. – I. de Mailloc – F. de Mailloc.
564. – Le 10 nov. 1713, la nomination à la cure du Mesnil-Guillaume appartenant au seigr du lieu, Mesre François de Mailloc de Toutteville, chever, seigr châtelain du Mesnil-Guillaume, Argences et autres lieux, nomme à cette cure, vacante par la mort de Me Louis Moëssard, pbrê, dernier titulaire, la personne de Me Jean-Baptiste Graindorge, pbre, vicaire de Bournainville. Fait au château du Mesnil-Guillaume, en présence de Mesre Nicolas du Houlley, Esc, seigr de Gouvis, étant présentement aud. château, et René Delahaye, couvreur en ardoise, demeurant au Mesnil-Guillaume.
Le 17 nov. 1713, Mre de Matignon, vic. gl, donne aud. sr Graindorge la collation dud. bénéfice. Le 29 nov. 1712, le sr Graindorge prend possession de la cure du Mesnil-Guillaume, en présence de Me Guillaume Champion, pbfê, curé de Bournainville et doyen de Moyaux, et de plusieurs paroissiens dud. lieu.
222. – Le 25 fév. 1715, vu l’attestation du sr Graindorge, curé du Mesnil-Guillaume, et du sr Poplu, vicaire de Glos, dispense de bans pour le mariage entre Etienne Dubois et Marie St-Denis.
751 . – Le 13 sept. 1724, titre clérical fait en faveur de Me Jean Thillaye, acolyte, par Jean Thillaye, marchand, demeurant au Mesnil-Guillaume.
Le Mesnil-Guillaume
Curés. – L. Moissard – J.-B. Graindorge.
Clerc. – J. Thillaye.
Patron. – Le seigneur du lieu. – F. de Mailloc, X.
331. – Le 8 nov. 1740, le seig évêque donne la collation de la cure de N.-D. du Mesnil-Guillaume à Me Marin Grosdhomme, pbfë de ce diocèse (parr. de Cernay), nommé à ce bénéfice par Mesre Joseph Durey de Sauroy, Escr, seigr et patron du Mesnil-Guillaume, en conséquence de la mort de Me Jean-Baptiste Graindorge, dernier titulaire. –
(L’acte de présentation ne se trouve pas dans le registre des Insinuations).
Le 17 nov. 1740, led. sr Grosdhomme prend possession de la cure du Mesnil-Guillaume, en présence de Me Pierre Férey, pbrë, curé de Fervaques ; Me Guillaume-Pierre Milcent, pbrë, curé de S’ Aubin-sur-Auquainville, et autres témoins.
41. – Le 22 juin 1741, la nomination à la cure de Ste Agathe du Mesnil-Guillaume appartenant au seigr du lieu, Mesre Joseph Durey de Sauroy, chevr, seigr et patron du Mesnil-Guillaume, seig* du duché-parrie de Damville, des Grandes et Petites Minières, Gouville, Maudey, Martigny-le-Comte, Champlisy, baron de Marizy, Montigny-sur-Avre, Montuel, Beauvillers, Marcilly-la-Campagne, Tranchevilliers et autres lieux, conser du roy en ses conseils, commandeur trésorier général de l’Ordre royal et militaire de St-Louis, nomme à lad. cure du Mesnil-Guillaume, vacante par la mort de Me Marin Grosdhomme, pbrë, dernier titulaire, la personne de Me Jean Donnet, pbrë, vicaire de Brétigny. Donné à Paris, en l’hôtel dud. seigr situé au Marais, rue Chartot, parr. St-Nicolas-des-Champs.
Le 4 juillet 1741, le seigr évêque donne aud. sr Donnet la collation dud. bénéfice.
Le 12 juillet 1741, le sr Donnet prend possession de la cure de N.-D. du Mesnil-Guillaume, en présence de Me Pierre-Bernard de Lamare, pbrë, curé de Brétigny; Me Jean-Baptiste d’Angerville, pbrë, desservant le bénéfice du Mesnil-Guillaume ; François Peulevey, sr de la Chapelle, commis à la recette des tailles de Lx, et autres témoins.
C’est par erreur que le présentateur a indiqué Ste- Agathe comme première patronne de la paroisse du Mesnil-Guillaume. Je crois qu’elle est seconde patronne.
Le Mesnil-Guillaume
Curés. – J.-B. Graindorge – M. Grosdhomme, – Jq Donnet.
Prêtre desservant. – J.-B. d’Angerville.
Patron. – Le seigneur du lieu. – J. Durey de Sauroy.
35. – Le 6 avril 1772, la nomination à la cure de N.-D. du Mesnil-Guillaume appartenant au seigr du lieu, Mesre François Le Mercier, chevr, seigr et patron du Mesnil-Guillaume, haut-justicier dud. lieu et de St-Jean-de-Livet, chevalier de l’Ordre militaire de S’ Louis, ancien commandant de l’artillerie du Canada, nomme à lad. cure, vacante par la mort de Me Gilles Le Roy, dernier titulaire, la personne de Me Jacques Paulmier, pbrë du diocèse de Lx, (parr, de St-Cyr-de-Salerne), vicaire de St-Georges-du-Mesnil. Fait et passé à Lx, en la maison canoniale de Mr Le Mercier, en présence de Louis Bordeaux, fabricant de toiles, et antres témoins.
Le même jour, le seigr évoque donne aud. sr Paulmier la collation dud. bénéfice.
Le lendemain, le sr Paulmier prend possession de la cure du Mesnil-Guillaume, en présence de Me Gilles Gosselin, pbre, desservant lad. parr., Guillaume Le Roy, vivant de son bien, demeurant à S’ Germain de Pontaudemer, et autres témoins.
M. Paulmier était a la fois maire et curé du Mesnil-Guillaume en 1791 ; il avait alors 54 ans. Il ne consentit à prêter le serment constitutionnel qu’avec des restrictions qui furent trouvées injurieuses par le Directoire de Lisieux, et il fut destitué. Cependant il ne quitta pas immédiatement la paroisse. Le Vendredi-Saint de cette même année, les habitants de Courtonne-la- Ville et ceux de St-Martin-de-Mailloc vinrent pour l’empêcher de remplir ses fonctions. Le Directoire approuvait ces bandits, mais la municipalité soutenait le curé. Cependant celui-ci dut céder à la force; il se retira chez son frère, l’un des notables de St-Cyr de Salerne. Mais là, sa présence compromettait les siens sans assurer sa propre sécurité. Il prit un passe-port pour l’Angleterre le 17 septembre 1791 et s’embarqua à Honfleur; il se retira à Londres. Apres la Révolution il revint en France et fut remis en 1803 à la tête de la paroisse du Mesnil-Guillaume. Il y mourut en 1823, à l’âge de 86 ans . – (Archives du Calvados. – Archives de l’évêché de Bx. – Ordo de Bx.)
129. – Le 21 août 1783, Jacques Bouteiller, marchand, demeurant à Glos-sur-Lisieux, constitue 150 livres de rente en faveur de son fils, Me Nicolas-Jacques-François Bouteiller, acolyte, afin qu’il puisse parvenir aux ordres sacrés. Cette rente est garantie par François Thieulin et Pierre Chatellier, marchands-papetiers, demeurant au Mesnil-Guillaume. Fait et passé en l’étude de Me Nicolas-Antoine Dubos, notaire au siège de Glos et demeurant au Mesnil-Guillaume, en présence de Me Louis Lefranc, acolyte d’icelle parr., et autres témoins.
Me Bouteiller était vicaire de la Groupte en 1791. Il refusa le serment schismatique et s’exila dans les Pays-Bas. Etant rentré de très bonne heure en France, il fut arrêté en 1799 et envoyé à l’île de Bé où il arriva le 26 oct. : il s’évada au mois de mai 1800. Nous le retrouverons à Lisores en 1801 et 1802, faisant des baptêmes avant la réorganisation du culte. Il fut nommé curé de cette paroisse en 1803 et après l’avoir administrée pendant plus de trente ans avec tout le zèle que l’on peut attendre d’un confesseur de la foi, il y mourut le 13 avril 183’i, à l’âge de 74 ans. (Archives du Calvados. – Mss de Reux. – Archives de la mairie de Lisores.)
François Le Mercier, Escr, chevalier de l’Ordre royal et militaire de St-Louis, ancien commandant de l’artillerie du Canada, seigr et patron du Mesnil-Guillaume.
350. – Le 3 août 1784, Jacques Hamon, marchand-tisserand, demeurant à St-Pierre-de-Mailloc, constitue 150 livres de rente en faveur de Me Louis Lefranc, acolyte du Mesnil-Guillaume, afin qu’il puisse parvenir aux ordres sacrés. Fait et passé par devant Me Nicolas-Antoine Dubos, notaire pour le siège de Glos, demeurant au Mesnil-Guillaume.
181 . – Le 15 avril 1786, furent ordonnés prêtres : Me Louis Lefranc, de la parr. de Mesnil-Guillaume.
Le Mesnil-Guillaume
Curés. – G. Leroy – Jq Paulmier.
Prêtre desservant. – G. Gosselin.
Clerc. – L. Lefranc.
Patron. – Le seigneur du lieu. – F. Le Mercier.
Notables – P. Chatellier – X.-A. Dubos. – P. Thieulin.
Fabrique de papier. – François Thieulin et Pierre Chatellier, marchands-papetiers.
Inventaires Sommaires Des Archives Départementales Antérieures à 1790
Reconnaissance devant Jean-Baptiste de Livet , notaire au siège de Glos , par Yves de Mailloc , écuyer, sieur de Touleville , seigneur et patron du Mesnil-Guillaume , conseiller du Roi , lieutenant particulier , civil et criminel en la vicomté d’Orbec , d’avoir traité avec Adrien de Mailloc , prêtre, chanoine de Lisieux , fondé de procuration de François de Mailloc , écuyer, sieur de La Morandière , de son office de lieutenant particulier , civil et criminel , moyennant 28,000 livres , dont s’est obligé ledit Adrien de Mailloc envers le vendeur ( 1693 )
5 – Archives ShL.
Cartulaire Shl avec inventaires ShL et sources bibliographiques diverses du Xe siècle à 1940:
1320 Fiefs de la Vicomté d’Orbec en 1320 :
La Sergenterie De Moyaux en ladite Vicomté d’Orbec
Nobles fiefs de la Sergenterie de Moyaux
Qui sont tenus du Roy notre Sire, qui en aurait la garde si le cas s’offrait
N° 11 – Le Mesnil-Guillaume – Guyot de Moyad tient un quart prisé valoir 30 livres par an
Item, ledit écuyer donne l’église du lieu qui vaut 40 sous. = Fiefs de la Vicomté d’Orbec en l’année 1320 in H. de Formeville, t. II, p. 388 (Extrait du Ms. suppl. f° 4, 2797, Comté de Beaumont, à la B.N.)
1407, 9 juin – Information de Jacques Poingnant, vicomte d’Orbec, pour la mise hors de garde noble de Jean de Bienfaite, écuyer, seigneur de Bienfaite, né en août 1386 et baptisé au Mesnil-Guillaume, fils de Robert de Bienfaite, chevalier, mort en août 1390, qui est en la garde du roi à cause de ladite seigneurie et possède aussi les fiefs de la Halboudière et de la Chaussière (Eure, canton de Rugles, commune de Juignettes) = Arch. nat. Dom Lenoir, 5, pp. 351-352.
1454, 30 novembre – Glos. Lettre devant Le Masuyer, comme Guillaume de Trousseauville fieffa de Mgr de Lisieux, une pièce de terre en pré assise à Glos par 40 sols de rente.
En 1470, Guillaume de Trousseauville, chevalier, seigneur du Mesnil-Guillaume, parut à la montre de Beaumont avec dix chevaux.= Formeville.- Hist. de l’Evêché-Comté t. II, p. 334 – Cartulaire de Thomas Bazin, f° 153,
1460, 27 mai – Mesnil-Guillaume. Guillaume Guéroult, fabriquier de l’église cathédrale de Lisieux, baille à rente à Thomas Frian, prêtre, curé du Mesnil-Guillaume, deux pièces de terre sises aud. lieu, à lad. fabrique appartenant, la première nommée les Vignes, jouxtes le chemin d’Orbec, la seconde nommées les Ylles en pré; jouxte l’eau courant de Orbec à Lisieux, moyennant 4 livres de rente par an.= Tabell. de Lisieux – Analyse Et. Deville
1475 – Lisieux. Nicolas Ier Le Vallois (fils de Guillaume), possesseur des seigneuries du Mesnil-Guillaume, de Putôt, de Bonneville-la-Louvet, et de la Rosière fait une fondation en l’église Saint-Jacques en 1475. = G. HUARD – essai de topographie lexovienne, p. 53
1504 – Mesnil-Guillaume. Perrin et Thomas Regnoult, du Mesnil-Guillaume, reconnaissent avoir pris à ferme pour six ans, commençant le jour de la Nativité Notre-Dame, de noble homme Guillaume de Saint-Florentin, écuyer, tout et tel droit de fermage que ledit Florentin avait pris du seigneur dud. lieu de Mesnil-Guillaume, en terres labourables et pâtures sauf certaines parties réservées, moyennant des conditions d’entretien et de communauté énumérées dans l’acte.
= Arch M.C. Fonds Et. Deville – Papier
1509, 11 juin – Mesnil-Guillaume. Guillaume de Saint-Florentin, écuyer, sieur de Coq, vend à Jehan Le Valloys l’aîné, écuyer, sieur de Mesnil-Guillaume, la terre et seigneurie du fieu de Coq à lui appartenant, tant en terres, bois, plant, pâtures, près, hommes, rentes, revenus, libertés et droitures appartenant aud. fieu sans en rien retenir situé en la paroisse de Glos et Mesnil-Guillaume. Ledit sieur Florentin avait acquit ce fief de noble homme Richard de la Rivière, écuyer, sieur de Brucourt. La vente est faite moyennant la somme de 300 livres tournois.
= Tab. de Lisieux – Analyse Et. Deville – I – 79
1515, 25 février – Lisieux. Michel Le Valoys bourgeois de Lisieux, fils et héritier en partie de feu Nicolas Ler Valoys en son vivant sieur du Mesnil-Guillaume vend et transporte à Guillaume Carrey marchand drapier demeurant à Saint Jacques de Lisieux un fief noble appelé le fief du Pin, à court et usage o toutes ses dignités et appartenances assis en la paroisse du Pin. Lequel fief led. défunt Levallois avait eu et acquis de Jehan de Bienfaite écuyer sieur de Moyaulx par lettres passées devant les tabellions de Lisieux le 22 juillet 1499. La vente faite moyennant 450 livres tournois. = Tab. de Lisieux – Analyse Et. Deville
1516, 14 juin – Lisieux. Partage de la succession de Guillemette Dupont, en son vivant femme de feu Nicolas Le Valloys, entre Jean Le Valloys l’aîné, seigneur de Mesnil-Guillaume, Jean Le Valloys, écuyer, seigneur de Putôt et Michel Le Valloys, écuyer, seigneur de la Rozière ses enfants. = Arch. M.C. – Fonds Et. Deville – Papier, 2 ff.
1539 – Mesnil-Guillaume. Thomas Obbidas, papetier. = Et. Deville.- Notes extraites du tab. de Lisieux
1540 – Mesnil-Guillaume – Nicolas de Saint-Florentin, pour lui et ses frères, Henri et Philippes, a baillé sa généalogie et extraction de noblesse ancienne avec la copie de plusieurs écritures, sur le nom de ses père et aïeul, et s’est néanmoins submis vérifier par témoins sa dite généalogie. AInsi requis par le procureur du Roi, ou autrement, qu’il soit assis.
– Henri et Philibert de saint-Florentin se sont aidés de semblable généalogie que Nicolas leur frère aîné, en la paroisse du Mesnil-Guillaume; et pour ce que le dit Nicolas n’a icelle justifiée, le procureur du Roi a requis que les dits frères soient assis. V. le n° 72. = LA ROQUE ( P.E.M. Labbey de).- Recherche faite en 1540, par les Elus de Lisieux des nobles de leur Election, Caen, Poisson, 1827, In-8, 170 p. p. 31.
1546 – Mesnil-Guillaume. Jean Mignot, de Cheffreville, papetier. Et. Deville.- Notes extraites du tab. de Lisieux
1555 – Mesnil-Guillaume. Jehan Racine, prêtre. Et. Deville.- Notes extraites du tab. de Lisieux
1557 – Mesnil-Guillaume. Honoré Delannoy, de Courtonne-la-Meurdrac, vicaire. Et. Deville.- Notes extraites du tab. de Lisieux
1560 – Mesnil-Guillaume. Jehan Racine, prêtre. Et. Deville.- Notes extraites du tab. de Lisieux
1562 – Mesnil-Guillaume. Maistre Loys le Valloys, écuyer, seigneur de Mesnil-Guillaume xl l.
= Lebeurier ( P.-F. ).- Rôle des taxes de l’arrière-ban du bailliage d’Evreux en 1562 avec une Introduction sur l’histoire et l’organisation du ban et de l’arrière-ban, Evreux – Rouen, Huet – Lebrument, 1861, p. 95.
1564 – Mesnil-Guillaume. Jehan Racine, prêtre. Et. Deville.- Notes extraites du tab. de Lisieux
1575 – Mesnil-Guillaume. Contrat de mariage de Paul Bonhomme, papetier avec Françoise Rocquette. Et. Deville.- Notes extraites du tab. de Lisieux
1578 – Mesnil-Guillaume. Jehan Le Valloys, seigneur de Mesnil-Guillaume, y demeurant. = Tabell. de Lisieux – Analyse Et. Deville.
1604 – Brocottes. Vente par Jehan de Courseulles, sieur du Joncquay, à noble homme Charles Le Gouez, sieur du Port et de Mesnil-Guillaume, de deux pièces de terre sises à Brocottes. = AD Orne. H 207. Abbaye de Belle-Etoile
1673, 5 août – Mesnil-Guillaume. Par devant François Delivet et François Rioult, Charles Amiot, demeurant au Mesnil-Guillaume, tuteur des enfants de feu Robert Amiot, fait remise à Pierre Chouard, sieur de La Ransonnière, écuyer, époux de Damoiselle Marie Amiot, tous les héritages de Robert Amiot, moyennant la somme de 900 livres.
Témoins : Jean Mourier, de Saint-Jean-de-Livet et Jacques Legrand. = Arch. SHL – Parch. 2 ff. – Analyse Et. Deville
1738, 10 mai – Lisieux. Par devant Pierre Formage notaire garde-note à Lisieux Guillaume Lemérière demeurant la paroisse de Moyaux héritier de damoiselle Françoise Gravois sa mère et damoiselle Jeanne Gravois veuve du sieur Guillaume Marguerie demeurant Lisieux, paroisse Saint Jacques…. vend à… Maitre Pierre Le Vallois, Bailly haut justicier du chapitre prébendes et dignités de l’église cathédrale de Lisieux subdélégué de Monsieur l’Intendant demeurant à Lisieux sus dite paroisse Saint-Jacques… douze pieds de terre en carré à prendre dans une pièce de terre en herbe nommée la Cour Gravois sise sur la douve du fossé ou chemin tendant de la porte d’Orbec à la Barre au Cinq du jardin dudit sieur acquéreur contre iceluy sur le bord dudit chemin bornés iceux douze pieds de terre par un côté et par un bout desdits sieur et demoiselle vendeur sur l’autre côté de ladite douve du fossé ou chemin tendant à ladite barre et par l’autre bout du mur du jardin dudit sieur Le Vallois acquéreur pour desdits douze pieds… cette vente faite par le prix et somme de douze livres…= AD 14 F6708, 1 p. parch.
1741, Samedi 3 juin – Lisieux. Par devant Pierre Formage notaire garde-note à Lisieux Guillaume Lemérière demeurant la paroisse de Moyaux héritier de damoiselle Françoise Gravois sa mère et damoiselle Jeanne Gravois veuve du sieur Guillaume Marguerie demeurant Lisieux, paroisse Saint Jacques…. vend à… Maitre Pierre Le Vallois, Conseiller du Roy, Bailly haut justicier du chapitre prébendes et dignitez de l’église cathédrale de Lisieux subdélégué de Monsieur l’Intendant et avocat fiscal au bailliage dudit Lisieux et y demeurant à Lisieux sus dite paroisse Saint-Jacques… une petite pièce de terre en herbe à prendre dans une pièce de terre en pareille nature nommée la Cour Gravois sise sur la douve du fossé ou chemin tendant de la porte d’Orbec à la Barre depuis et compris une grosse épine Blanche qui est dans la haye de ladite herbage La plus proche du mur du jardin dudit sieur Le Vallois a aller gagner depuis l’extrémité de ladite épine droit à la rivière d’Orbec qui règne le long de ladite herbage, laquelle petite portion de terre vendue contient de longueur environ depuis et compris ladite épiné a gagner en droiture à ladite rivière quarante six pieds ou environ, en y comprenant les douze pieds que lesdits sieurs et demoiselle vendeur ont cy devant cédée audit sieur Le Vallois le dix de mai mil sept cent trente huit Ladite portion de terre vendue relevante de la prébende des Loges en exemption de toutes charges et rentes, Bornée icelle portion par un côté et par un bout desdits sieur et demoiselle vendeur et de ladite rivière et par l’autre côté de ladite douve du fossé… cette vente faite par le prix et somme de trente quatre livres… = AD 14 F6708, 1 p. parch.
1756 – 1868 – Mesnil-Guillaume. Cession d’un moulin à papier par la veuve Dallençon, exploité par Nicolas Dubosc, maître de l’un des moulins à papier de Mesnil-Guillaume et pièces diverses le concernant. Plans d’une annexe de l’usine de Glos. Pièces de procédure du fossé pour le chemin de l’église. = Arch. SHL – 3F 88 – Fonds Cailliau – 6 pièces parch., 8 pièces papier. Analyse Et. Deville
1782, 15 juin – Lisieux. Par devant Guillaume Gabriel Daufresne, Licencié ès Loix, reçu provisoirement en Bailliage à Orbec à l’exercice et fonction de notaire du Roi à Lisieux, soussigné fut présent François Le Mercier, Ecuyer, Chevalier de l’Ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien Commandant de l’artillerie du Canada, seigneur et patron du Mesnil-Guillaume, haut justicier de la dite paroisse et de celle de Saint-Jean de Livet, demeurant à Lisieux, paroisse Saint-Jacques, Lequel a reconnu avoir par ces présentes vendu, quitté, cédé et délaissé avec promesse de garantie de tous troubles, dettes, hipotesques (hypothèques) évictions et autres empeschemens quelconques
Au sieur Pierre Alleaume, marchand, demeurant en cette ville, paroisse Saint-Germain, à ce présent et acceptant acquéreur pour lui ses hoirs ou ayant cause, Savoir:
Une maison neuve qui appartient au sieur Le Mercier, et qu’il vient de faire construire à la place de l’Auberge de la Levrette sise en cette ville, faubourg de Paris, paroisse Saint-Jacques, ainsi qu’elle se contient dans son enclos, et circonstances et dépendances bornée d’un côté au midy par la rue de faubourg de Paris, d’autre côté au Nord par la cour dudit sieur vendeur, d’un bout au Levant par la veuve Fontaine, et d’autre bout au Couchant par ledit sieur vendeur.
Pour de la dite maison, jouir, faire et disposer par ledit sieur acquéreur comme de son propre et de chose lui appartenant de ce jour jusqu’à l’avenir, aux conventions et conditions suivantes, savoir:
1° Les murs et parois d’entre ladite maison vendue et la maison qu’occupe ledit sieur Le Mercier, seront mitoyens entre lui et dit sieur Alleaume, et chacun d’eux aura la liberté d’y afficher de son côté à la charge de les réparer et entretenir à l’avenir, à frais communs.
2° Les Parties ne pourront de côté ni d’autre aire aucune battisse qui excède la hauteur du mur faisant séparation d’avec la cour ddit sieur Le Mercier.
3° Ledit sieur Alleaume pourra, s’il le juge à propos, faire reconstruire l’écurie dépendant de ladit maison vendue et il aura le droit d’avancer ladite écurie dans toute sa longueur d’un pied et demi en dedans de la cour dudit sieur Le Mercier Et encore, il aura la liberté de faire et ouvrir dans la muraille ou parois de ladite écurie, sur la cour dudit sieur Le Mercier deux ou trois jours à châssis dormant qui seront grillés de barres de fer à la hauteur d’homme, sans que cela puisse empêcher ledit sieur Le Mercier d’y afficher des crochets dans cette même muraille ou parois qui appartiendra audit sieur Alleaume.
4° Le sieur Alleaume supportera le tuyau de la fontaine depuis sa porte jusqu’au réservoir placé sur son terrain, lequel réservoir sera commun entre les parties, ainsy que ledit tuyau qui sera arrangé de façon à verser également de l’eau dans les bassins des dites parties, le tout, au moyen et parce que les réparations desdits tuyaux et réservoirs seront faits à frais communs, Et que la rente de dix livres, faite à l’Hôtel de Ville pour le droit de cette fontaine, sera payé et acquittée à l’avenir par lesdites parties, moitié par moitié.
5° Pour réparer et couvrir réciproquement sur leurs maisons, les parties auront le droit respectif du tour d’échelle sur leur terrains et d’y faire passer à cet effet les matériaux nécessaires, sans que ce droit puisse s’étendre plus loin que dans le cas de réparation de couverture.
6° Le dit sieur acquéreur tiendra ladite maison vendue, mouvante, en franche bourgeoisie, des seigneurs dont elle relève par foi et hommage seulement, les parties ayant déclaré ne point connaître nommément lesdits seigneurs.
La présente vente ainsi faite et en outre moyennant la somme de dix neuf mille livres de prix principal, francs deniers venant aux mains du dit sieur vendeur, de laquelle somme de dix neuf mille livres, ledit sieur vendeur reconnaît avoir reçu avant ce jour, du dit sieur acquéreur, celle de quatre mille livres en espèces ayant cours, dont il se tient content, satisfait et bien payé, en quitte et décharge d’autant le dit sieur acquéreur.
Et à l’égard des quinze mille livres restantes, le dit sieur acquéreur les a présentement soldées au dit sieur vendeur en deux billets de son fait au profit de ce dernier, payables sans intérêts, savoir l’un de six mille livres à la fin d’août prochain et l’autre, de cinq mille livres à Noël prochain Et en outre en un autre billet de quatre mille livres, payables au vingt pour trente août prochain, dans Paris, du fait de Bidault, à l’ordre du dit sieur Alleaume qui l’a passé à celui du dit sieur Le Mercier.
Le défaut de représentation desquels trois billets montant ensemble à la dite somme de quinze mille livres vaudra quittance de ladite somme, a dit sieur acquéreur sans qu’il ait besoin d’en justifier de particulière ni de requérir aucun émargement sur ces présentes à cet égard parce qu’à la sûreté et garanties desdits billets jusqu’à leur parfait acquit, l’objet vendu en demeure spécialement affecté et hypothéqué, et en outre ledit sieur Alleaume y oblige et affecte tous ses biens présents et à venir…..
…Fait et passé à Lisieux en l’étude, le samedy avant midy quinze juin mil sept cent quatre-vingt deux, présence du sieur Michel Théodore Magloire Balleroy et Gille Le Peton, praticien, demeurants en cette ville…
= Arch. coll. Daniel Deshayes, Lisieux. Copie MC, 17.08.1992. Parchemin, 4 ff. = Archives SHL1F33 –
1793 – Mesnil-Guillaume. COMITE de SURVEILLANCE – Mesnil-Guillaume, 1793. = Arch. dép. du Calvados – Série L.
1838-1867 – Mesnil-Guillaume. Pièces diverses relatives à la réglementation d’eau des usines. = Arch. SHL – 3F 89 –
Fonds Charles Vasseur .
Doyenné d’Orbec ; « Doy ; d’Orbec.doc »
11 – LE MESNILGUILLAUME
Insinuations
Sous l’invocation de Notre Dame
Curés :
Le Roy 1764..
Paulmier 1772/1787
Description de l’église d’octobre 1861 et mai 1853
Note de Pannier : Dans la vallée d’Orbec, s’élève la petite église de Mesnil-Guillaume dont les murs primitivement romans ont été réparés au 15e siècle. Son nouveau clocher construit en charpente et surmonté d’une pyramide octogone dans le style du 15e siècle et muni à sa base de plusieurs abat-sons et décoré sur les angles de petites lucarnes d’un aspect pittoresque.
Note sur la litre funèbre :Sur la litre funèbre on distingue un blason avec un chevron et trois croissants.
Par dessus un autre blason plus grand ayant un lion pour support : les pièces sont invisibles.
Description de la cloche :
J’ai été bénie par Messire jacques Paumier curé d Mesnil-Guillaume et nommée Marie Anne par Monsieur Guy Liard, maire et parrain et Dame Marie Anne Chemin, marraine épouse de Monsieur Gabriel Lenormand.
Lavillette de Lisieux m’a faite
Du 10 avril 1862 : Petite note sur les corbeaux qui aident à supporter les sablières de la voûte de la nef.
Description du château et son historique
Le château a été bâti vraisemblablement par Nicolas le Vallois d’Ecoville, le constructeur de la Bourse de Caen. A la fin du 15e siècle aux montres de la noblesse de 1469, Monseigneur Guillaume de Trousseauville, chevalier seigneur de Mesnil-Guillaume, Guiverville et Morainville se présenta en habillement d’hommes d’armes, lances fournies et deux archiers le tout à 6 chevaux. La filiation de cette branche de la famille le Vallois remonte à Jean le Valois, sieur d’Ecoville et de Mesnil-Guillaume qui vivait en 1511 et eut pour fils Nicolas le Vallois qui épousa en 1534 Marie du Val, veuve de Nicolas de Grandrue. Il était seigneur d’Escoville, Fontaines, Mesnil-Guillaume et Marmeville. Il mourut le jour des rois en 1541, suivant de Bras, à l’âge de 47 ans d’une apoplexie. Il laissait 4 fils qui ont fait branche : Louis, seigneur de Fontaines, Etoupefour, Villette et le fief des Esmares, secrétaire des finances, François, seigneur de Verscoville ou des Billes, homme d’armes de la compagnie du Duc de Longueville, Jean, seigneur de Mesnil-Guillaume et du Coq, et le dernier Nicolas, seigneur de Marmeville et Launay, furent maintenus dans leur noblesse en 1572, 1576 et 1577.
La branche de Mesnil-Guillaume s’éteignit au 17e siècle dans la personne de Noble Damoiselle Marie le Valois, veuve de feu Charles le Goys, vivant écuyer, sieur du Parc et de Meneville, dame du fief noble terre et sieurie de Mesnil-Guillaume qui vivait en 1613 et 1617 suivant un aveu et une acquisition où elle est mentionnée.
Le Valois portait d’azur au chevron d’or accompagné de trois croissants d’argent au chef du même chargé de trois roses de gueule.
En 1709 la terre était passée à la famille de Mailloc, ainsi que le mentionne un acte du 22 février
Où l’on voit figure Messire François de Mailloc chevalier, seigneur d’Etouville, Mesnil-Guillaume et autres terres et seigneuries, demeurant ordinairement en son château de Mesnil-Guillaume.
Mémoires de la Société des Antiquaires du 30 novembre 1419 en latin et du 2 décembre 1419. toujours en latin
D’autres fiefs que celui à qui elle avait donné son nom s’étendaient sur le territoire de cette paroisse. En 1540 les élus de Lisieux y trouvèrent Nicolas de St Florentin qui n’a aucune qualification de terres après son nom. Il avait deux frères Henry et Philippe ou Philibert, qui habitaient la paroisse voisine de Glos.
Un acte d’échange des terres du 1er mai 1557 nous fait connaître le fief aux Hues sieurie appartenant aux sieurs du chapitre de Lisieux.
Ansgot fils de Hugues de Mesnil-Guillaume donne à l’Abbaye de St André en Gouffern la moitié du patronage de l’église de Mesnil-Guillaume.
Sépultures dans le cimetière de Mesnil-Guillaume :
Charles François Aignan Margeot de St Ouen, chevalier de la Légion d’honneur mort le 7 septembre 1842,âgé de 67 ans
Messire François de Margeot chevalier de St Louis, mort le 19 juin1819
Lettre de L’abbé Loir du 13 janvier 1885 et réponse de Charles Vasseur du 20 janvier 1885 au sujet des Le Valois de Mesnil-Guillaume.
1605
« Jean Le Vallois mourut en 1605. Le château échut à l’une de ses filles, p. 6 Marie Le Vallois, qui avait épousé Charles Le Gouez, sieur du Port.
La famille Le Gouez devait garder Mesnil-Guillaume pendant plus de cinquante ans et c’est alors que se prépara, derrière ces murs, construits pour la douceur de vivre et pour la paix, la plus poignante des tragédies.
» Charles Le Gouez et Marie Le Vallois avaient eu un fils aîné, prénommé Louis, qui fut, après la mort de son père, seigneur du Port et de Mesnil-Guillaume. Il avait fait un très brillant mariage en épousant Melle de Raveton, fille de François de Raveton, seigneur de Chauvigny, chevalier de l’ordre du roi, gentilhomme de sa chambre, et de Marie de Bruslars de Genlis, veuve de François de Mailloc, seigneur de Cailly, dame d’honneur de la Reine-Mère.
» C’était un ambitieux et un homme dénué de scrupules.
« Il avait une nièce, fille du frère de sa femme, orpheline, dont la tutelle lui fut confiée. La jeune personne était fille unique et fort riche. elle possédait entre autres la seigneurie de Carentonne, près de Bernay.
« Louis Le Gouez ne cacha pas son intention de marier cette riche héritière à l’un de ses trois fils, mauvais sujet peu recommandable. La famille de la jeune femme s’en émut. On savait qu’il ne négligerait rien pour mener à bout cette union qui aurait fait de son fils, l’un des plus puissants seigneurs de la région.
« On procéda par voie légale; une délibération de parents lui ôta la garde de la jeune fille, qui fut confiée à l’une de ses tantes, Marie de Raveton, abbesse de Lisieux; puis, en 1643, un jugement rendu sur un nouvel avis du conseil de famille, destitua le seigneur du Mesnil-Guillaume de ses fonctions de tuteur. Enfin, on maria Melle de Raveton à Jacques de Maudouit, seigneur du Renouard-sur-Coquainvillers.
» M. de Mesnil-Guillaume était fou de rage: non seulement ces décisions étaient humiliantes, mais encore, elles ruinaient un projet qui aurait bien servi ses intérêts.
« Un jour que le jeune ménage était chez M. de la Rozière, le sire de Mesnil-Guillaume se rendit chez ce gentilhomme accompagné de ses deux plus jeunes fils. Ils pénétrèrent à main armée dans la demeure et tuèrent M. de la Rozière, Jacques de Maudouit, n’épargnant même pas la jeune femme qui fut blessée mortellement.
» Ce triple assassinat, accompli avec la plus atroce barbarie, se termina par une scène de pillage: la maison des victimes fut saccagée. Les meurtriers enlevèrent les meubles, dont l’estimation fut évaluée à 12.000 livres, chiffre considérable pour l’époque.
» Mais, le châtiment ne devait pas se faire attendre longtemps. Tombés aux mains de la justice, le seigneur de Mesnil-Guillaume et ses fils, expièrent leur forfait par une juste condamnation à la peine capitale.
« La véritable victime de ce triple meurtre fut le fils aîné de l’assassin, François le Gouez: bien qu’il n’ait pas participé à l’assassinat puisqu’il servait aux armée pendant que s’accomplissait l’affreuse tragédie, il porta sur ses épaules tout le poids de l’infamie. Non seulement on le montra du doigt mais encore, il fut totalement ruiné. Il dut payer d’énormes dommages et intérêts aux parents des victimes; Mesnil-Guillaume fut alors exproprié par décret et adjugé à Louis, marquis de Rabodange, en 1646. valant 5 à 6 m. 1. t. de rente ;
« Accablé par un si douloureux souvenir et par une situation si lamentable, François Le Gouez quitta les armes pour entrer dans les ordres. Il fut prêtre et curé de Cruloy, près de L’Aigle. C’est dans cette petite cure de campagne, qu’il offrit au seigneur ses mérites et ses prières pour le rachat spirituel de son père et de ses deux frères.
« La terre de Mesnil-Guillaume ne resta pas longtemps dans la maison de Rabodanges. Elle fut revendue, au bout de quelques années à Yves de Mailloc, sieur de Toutteville, originaire d’Orbec. Ce dernier mourut en 1694, à l’âge de cinquante-sept ans; son fils, François de Mailloc, qui fut après lui seigneur de Mesnil Guillaume, vendit à son tour le château à Joseph Durey de Sauriy, seigneur de Damville, en 1720. Celui-ci mourut en 1752 et les Mesnil-Guillaume fut de nouveau vendu à M. Lemercier ancien commandant de l’artillerie au Canada. Cet officier distingué était seigneur de Mesnil-Durand au moment de la Révolution.
« Au XIXe siècle, le Mesnil-Guillaume a été possédé par la famille de Margeot et par la comtesse le Bel de Penguilly. La comtesse de Valmy habita pendant plusieurs années le château, en qualité de locataire.
« Au début de ce siècle, les Penguilly vendirent le Mesnil-Guillaume à un sud américain nommé Riva Corti, dont nous avons parlé à propos des transformations apportées au château. Riva Corti vendit à son tour à Charles Humbert, l’homme des » canons et des munitions ».
Charles Humbert vendit à Voltera ; Voltera à Melle Chanel [La créatrice de mode Coco Chanel achète le château pour son neveu André Palasse; Melle Chanel à Mme de La Panouze, la parente de notre ambassadeur à Londres ; et Mme de La Panouze à Mme de La Taille.
Plus récemment, Charles Leclerc de Hauteclocque, fils du Maréchal Philippe Leclerc [ l’un des principaux chefs militaires de la France libre durant la Seconde guerre mondiale ] a été propriétaire du château – et fut également maire de la commune – Il est décédé accidentellement, le 17 juillet 2016, à l’âge de 87 ans en son château du Mesnil-Guillaume.
Henri PELLERIN, » Les derniers seigneurs de Mesnil-Guillaume », PA, 6, N° 11, Nov. 1956, pp. 12-14
François de Mailloc sieur de Toutteville, dont la famille habitait Orbec, vendit le Mesnil-Guillaume à Joseph Durey du Sauroy, en 1720. Le nouveau seigneur de Mesnil-Guillaume avait alors quarante-trois ans. Il était trésorier à l’extraordinaire des guerres » et l’énumération de ses titres en dit long sur sa fortune et son rang0
« Dans l’acte de nomination de M. Jean Donnet, comme curé du Mesnil-Guillaume, le 22 juin 1742, Dyrey de Sauroy s’intitule: » Chevalier, seigneur et patron de Mesnil-Guillaume, seigneur du duché-pairie de Damville, des grandes et petites Minières, Gouville, Maudey, Martigny-le-Comte, Champlisy, baron de Marizy, Montigny-sur-Avre, Montuel, Beauvillers, Marcilly-la-Campagne, Tranchevillers et autres lieux, conseiller du Roy en ses conseils, commandant trésorier-général de l’Ordre Royal et militaire de Saint-Louis ».
« Dans cette longue énumération, deux titres émergent d’une façon marquante: celui du duché-pairie de Damville et celle de commandant-trésorier-général de l’Ordre de Saint-Louis.
« … Dufort de Cheverny, dans ses mémoires, le cite parmi les grands noms de la société parisienne de son temps. Il avait épousé Marie-Claire du Terrail d’Estaing, l’une des arrières-petites-filles du chevalier Bayard.
Ajoutons qu’il habitait Paris, dans un magnifique hôtel, au quartier du Marais, rue Chartot, paroisse de Notre-Dame-des-Champs [28]
C’est certainement lui qui aménagea le beau perron, décoré d’une grille en fer forgé, dans la cour intérieure du château de Mesnil-Guillaume.
Il mourut en 1752.
« Ce fut son fils, prénommé Joseph, comme lui, qui lui succéda, en qualité de seigneur du Mesnil-Guillaume. Celui-ci fut particulièrement flatté de descendre, par sa mère, du chevalier Bayard. Aussi, au lieu de se nommer Durey de Sauroy, comme son père, préféra-t-il relever le titre de Marquis du Terrail. On l’appelait couramment Durey du Terrail.
« … Joseph Durey du Terrail mourut en 1770. Il n’avait pas d’enfants, et ses biens passèrent à son neveu le duc de Cossé-Brissac, qui devait mourir tragiquement à Versailles, lors des émeutes du début de la Révolution.
» C’est François Le Mercier qui succéda aux Durey de Sauroy et du Terrail, sur la terre du Mesnil-Guillaume.
» Ce dernier avait passé une bonne partie de sa vie au Canada, où il occupait le poste important de commandant général de l’artillerie.
« Rentré en France, il vint se fixer en Normandie, où nous le voyons seigneur de Saint-Jean-de-Livet et du Mesnil-Guillaume. Il avait également une maison à Lisieux, où il résidait souvent. Il était chevalier de Saint-Louis.
« C’est lui qui clôtura la liste des seigneurs du Mesnil-Guillaume, sous l’Ancien Régime. »
[1] Quelques unes des références données par C. HIPPEAU dans son Dictionnaire topographique du département du Calvados , Paris, Imp. nationale, 1883, p. 188. ne paraissent pas concerner notre site.
[2] FORMEVILLE , II, p. 396..
[3] Auguste LONGNON , Pouillés de la province de Rouen , p. 253 d.
[4] Auguste LE PREVOST .- Pouillés du diocèse de Lisieux , Caen, 1844, pp. 34-35.
[5] Ce patronyme de Brionne pourrait venir de la terre de Brionne, située à Serqueux, près d’Orbec » Parmi les nombreux enfants de Robert II de Harcourt et de Jeanne de Meulan nous trouvons Gautier, sieur de Brionne, qui transmit ce titre à ses descendants; mais ils le prenaient d’un fief de Brionne, voisin de Cerqueux, près Orbec » in LE PREVOST Auguste .- Mémoires et notes , t. I, p. 441, d’après Histoire de la Maison d’Harcourt , II, p. 1973.
[6] Nous pensons que ce doit être Jean de Brionne, chevalier, seigneur de Morsan, mentionné dans un rôle de 1304, plutôt que Jean de Brionne, chevalier, seigneur de Manneville qui ne figure que dans des actes de 1372 et 1404.
[7] » Guillaume de Trousseauville, écuyer, seigneur du Mesnil-Guillaume (calvados, arrondissement de Lisieux); âgé e 30 ans en 1449 il dépose comme témoin dans l’information ouverte dans le procès soutenu par Thomas Basin contre les habitants de Marolles. Basin éd. Quicherat, t. IV, p. 169, pièce justificative XI.) Ce personnage figure aussi dans les lettres de grâce et de pardon accordées par Louis XI à la ville de Lisieux en décembre 1465 (Stein, Charles de France , pièces justificatives XXII, p. 562.)
[8] » De même, un brave chevalier, Guillaume de Trousseauville, venant également de Paris, affirmait sous serment que le roi lui avait dit, au moment où il recevait de lui son ordre de départ » Allez chez vous, en Normandie; accueillez mon frère en qualité de duc et ne manquez pas de lui obéir et de la servir fidèlement comme tel ». Thomas BASIN, Apologie ou plaidoyer pour moi-même éditée et traduite par Charles Samaran et Georgette de Groër, Paris, 1974, in-8°, xij-285 p. (Coll. Les Classiques de l’Histoire de France); p. 45″
[9] Gilles de Trousseauville, en 1518 et Jean de Trousseauville en 1538, rendirent aveu pour le fief de Bonnebosc, relevant de Pont-Audemer, à Manneville-sur-Risle – Auguste LE PREVOST Auguste .- Mémoires et notes , t. II, p. 374.
[10] FRONDEVILLE Henri de .- Le Compte de la vicomté d’Orbec pour la Saint-Michel 1444 in Etudes lexoviennes , IV, pp. 211-212..
[11] Cartulaire de l’Evêché de Lisieux , f° 153, dans Henri de FORMEVILLE , Hist. de l’Evêché-Comté de Lisieux , t. II, p. 334-
[12] Henri PELLERIN , » Le Château de Mesnil-Guillaume », PA , 6, N° 7, Juillet 1956, pp. 1-7.
[13] Sur cette famille, voir notre communication à la Société Historique de Lisieux, 26 janvier 1990.
[14] t. II, p. 397
[15] Henry de FORMEVILLE , Histoire de l’ancien évêché-comté de Lisieux , p. dciii
[16] Voir à ce sujet Bernard SCHNAPPER , Les rentes au XVI° siècle – Histoire d’un instrument de crédit , Paris, SEVPEN, 1957, In-8°, 309 p.
[17] Autres constitutions de rentes par Jehan Blaisot, l’ainé, de Saint-Jacques – 26 avril 146O ; par Me Pierre Dunnans, curé de Fumichon – 2 janvier 1463
[18] SHL , N° 12, pp. 49-51 .
[19] Petit guide , p. 18.
[20] Voir Yves LESCROART , La Renaissance en Pays d’Auge dans La Renaissance en Basse-Normandie , numéro spécial de Art de Basse-Normandie , Printemps 1975, p. 63.
[21] Voir notre article sur Fumichon Michel COTTIN , » Le château de Fumichon », PA , 41, N° 2, Février 1991, pp. 14-21 ; 41, N° 3, Mars 1991, pp. 19-26.,
[22] Et non aux Le Valloys qui portent d’azur au chevron d’argent et à trois croissants d’argent comme nous le voyons écrit dans Art de Basse-Normandie , Printemps 1975, p. 63..
[23] Sur ce type de constructions, voir notre conférence: Michel COTTIN , Lisieux et ses constructions de bois. 1.- Lisieux et ses forêts. 2.- Les Charpentiers lexoviens et leurs oeuvres , Conférence à l’Espace Victor-Hugo (dans le cadre de la Foire aux Arbres, 5 mars 1990).
[24] Sur l’emploi de ce type de briques, voir: Michel COTTIN , La maison traditionnelle en Pays d’Auge – Matériaux et techniques. Catalogue exposition – Saint-Désir-de-Lisieux , Octobre 1985, s.l.n.d. (1985), 210 x 297, multigr., couv. ill.
[25] Voir à ce sujet l’exemple proche et un peu plus tardif du château du Pin et l’article d’Yves NEDELEC , L’école contentinaise d’architecture au XVIIe siècle , Communication à la SHAO, 9 février. Résumé dans BSHAO , Tome CX, N° 1-2, Mars-Juin 1991, pp. 9-20.
[26] Notes de M. Ch. Vasseur.
[27] Cette partie est bien certainement un reste d’un château antérieur. Elle comprend sept travées de pilastres d’ordre classique, déterminées par des bois d’un équarrissage beaucoup plus considérable, sculptées de ces larges feuillages à la mode sous le règne de François Ier . Mais, quand on a refait le rez-de-chaussée qui est en brique et les autres corps de logis, on s’est efforcé de moderniser cette bâtisse surannée. Les fenêtres ont été élargies et surélevées et on les a entourées de moulures accentuant le règne de Louis XIII. La grande filière godronnée qui séparait les deux ordres de pilastres a dû suivre les contours des nouvelles baies, ce qui la fait onduler comme un crénelage. Enfin on a mis sous la corniche de gros modillons en bois, dûment recouverts de plâtre.
[28] Ou de Saint-Nicolas-des-Champs.
Les Cahiers des Archives départementales du Calvados – n° 7 – 1996
Au Fil Des Moulins
Le Mesnil-Guillaume
– moulin à papier du fief du Mesnil-Guillaume (« droit de moulin à papier », aveu de 1695 ; « moulin à papier fieffé… », 1726 ; d’Anville, Jobey : « deux moulins à papier dans le même bâtiment »),
– moulin à blé du château, du fief de Mesnil-Guillaume (aveu de 1455, d’Anville).
En 1813 Jean-Eléonor Perrault obtient l’autorisation de construire une filature mécanique de coton au Mesnil-Guillaume; le même Perrault avait d’abord tenté sa chance dans la meunerie en obtenant en 1807 l’autorisation de construire un moulin à blé (situé en aval de la future filature).
Louis Moissard, curé du Menil-Guillaume : D’argent à un chevron de gueules accompagné de 3 oiseaux de sable.
888888888888888888888888
Information pour un procès soutenu par Thomas Basin contre les habitants de Marolles pour leur faire faire le guet a son château de Courtonne. 23 mars 1449.
Suivent les dépositions conformes de
– Guillaume de Trousseauville , escuier , seigneur du Mesnil-Guillaume, aagie de xxx ans.
– Huet des Sablons, de la paroesse du Mesnil-Guillaume, aagie de L ans.
8888888888888888888888888888888
Dictionnaire Topographique Du Departement Du Calvados – C. Hippeau
Mesnil-Guillaohe (Le), cany de Lisieux (2° section). — Mansum Willelmi, 1198 (magni rotuli, p. 43). — Mesnil Willelmi, 1208 (ibid. p. 96). — Mansus
Guillelmi, XIII° (ch. de Saint-André-en-Gouffern, n° 123). — Mesnillum Willelmi, 1250 (ch. De l’hospice de Lisieux , n° 47 ).—Mesnillum Guillelmi,
XIV° s (pouillé de Lisieux, p. 34).
Par. de Notre-Dame, patr, le seigneur du lieu.
Dioc. de Lisieux, doy. d’Orbec. Génér. d’Alençon,
élect. de Lisieux, sergent, de Moyaux.
Fief réuni à la baronnie de CuIey-le-Patry, 1649
(ch. des comptes de Rouen, t. III, p. 126).
Amiots (Les), h.- Bruyères (Les), h – Cesnes (Les), vill.- Chemin-de-Chambrais (Le), h..- Fosses (Les), h.- Route (La), vill.- Roy (Le), h. – Tuileries (Les), h. –
88888888888888888888888888888
État des anoblis en Normandie, de 1545 à 1661 – Abbé P.-F. Lebeurier
68. L. d’an. de Louis le Vallois, sieur de Fontaine Estoupesfour, de Villette, et du fief des Emiret de Pilly, et François le Valois, sieur d’Esvibles, homme d’armes de la compagnie du sieur de Longueville, Jean le Valois, sieur du Mesnil-Guillaume
et du Cocq, et Nicolas le Valois, sieur de Mainneville et de Cannay, comte de Costanville (sic), frères, déclarez maintenus et gardez en pleine et entière jouissance de leur estat et qualité de noblesse par lettres patentes don. a Paris le 25 aoust 1576, ver. ch. le 14 aoust 1577, et c. led. jour.
88888888888888888888888
Nobles Fiefs De La Sergenterie De Moyaux
Qui sont tenus du Roy notre Sire, qui en aurait la garde si le cas s’offrait
11.— Le Mesnil-Guillaume. — Guyot de Moyad tient un quart, prisé valoir 30 livres par an.
Mesnil-Guillaume, 74
8888888888888888888888888888
Archives du Calvados
(Calvados; jusqu’en 2015)
Canton actuel : Livarot
Arrondissement actuel :Lisieux
Code INSEE : 14371
Histoire administrative: A partir du 1er janvier 2016, Livarot forme avec Auquainville, Les Autels-Saint-Bazile, Bellou, Cerqueux, Cheffreville-Tonnencourt, La Croupte, Familly, Fervaques, Heurtevent, Le Mesnil-Bacley, Le Mesnil-Durand, Le Mesnil-Germain, Meulles, Les Moutiers-Hubert, Notre-Dame-de-Courson, Préaux-Saint-Sébastien, Saint-Martin-du-Mesnil-Oury, Saint-Michel-de-Livet, Saint-Ouen-le-Houx, Sainte-Marguerite-des-Loges et Tortisambert, la commune nouvelle de Livarot-Paysd’Auge (chef-lieu dans l’ancienne commune de Livarot), par l’arrêté préfectoral du 24 décembre 2015. TA Livarot-Pays-d’Auge (Calvados; à partir de 2016).
88888888888888888888888888888888888
La Normandie monumentale et pittoresque… Calvados.
Le château du Mesnil-Guillaume
La construction présente quatre faces entourant une cour intérieure. Un pavillon peu élevé, sans trace du pont-levis qui y a existé jadis, surmonte la porte d’entrée. Quatre tourelles flanquent les angles; celles de la face méridionale sont des poivrières en
cul-de-lampe. Les murs sont couronnés d’une corniche vigoureusement accentuée par la saillie des modillons; elle est coupée par l’extrémité supérieure des fenêtres, qui en fait ainsi valoir la puissance et le relief. Le tout présente un ensemble
très satisfaisant, et conserve un caractère d’unité remarquable. L’intérieur de la cour
répond à l’apparence extérieure, sauf le corps de logis formant le côté de l’ouest. Celui-ci appartient à une époque plus ancienne; c’est une construction en bois, qui peut dater du règne de Louis XII ou de celui de François Ier, tandis que le reste de l’édifice, bâti en pierre et pour lequel la brique n’a été employée que dans une faible
proportion, est du temps de Henri III. Mais cette partie, élevée en bois
de charpente et colombage, offre un bon modèle de ce genre original et pittoresque, et c’est à peine si l’on peut dire que l’ensemble du château en soit déparé.
Le Mesnil-Guillaume est l’oeuvre d’une famille qui a tenu une place considérable, soit à Caen, soit à Lisieux, pendant toute la durée du XVIe siècle, celle des Le Vallois.
Un premier Nicolas Le Vallois, fixé à Lisieux dans la seconde moitié du siècle précédent, y accumula une grande fortune par le commerce. Il se rendit acquéreur de la seigneurie du Mesnil-Guillaume, qui était depuis longtemps le patrimoine et la résidence d’une branche de la famille de Trousseauville, distinguée dans la chevalerie normande. Nicolas Le Vallois fit foi et hommage au roi pour ce fief en 1498; il fut aussi seigneur et patron de Putôt, terre importante de la vallée d’Auge, dont il rendit aveu en 1505.
Il laissa trois fils; Jean, l’aîné, seigneur du Mesnil-Guillaume, épousa Catherine de la Bigne, fille d’un riche bourgeois de Caen, et fut père d’un second Nicolas Le Vallois, surtout connu comme seigneur d’Ecoville. Celui-ci porta à son comble l’opulence de la famille. Ses contemporains ne pouvant s’expliquer les richesses qu’ils voyaient accumulées entre ses mains, les attribuèrent à ses connaissances dans l’art mystérieux de l’alchimie. Ce fut lui qui fit construire à Caen ce merveilleux
hôtel de la Renaissance, encore désigné par son nom, et resté, malgré toutes les dégradations qu’il a subies, un des plus précieux ornements de cette ville.
Nicolas Le Vallois mourut subitement à l’âge de quarante-sept ans, le 6 janvier 1542, frappé d’apoplexie au moment où il commençait son repas.
Il avait été marié deux fois, ayant épousé en premières noces, en 1523, Catherine Hennequin, et, en secondes noces, Marie du Val en 1534. De celle-ci naquit le troisième de ses quatre fils, Jean Le Vallois, son successeur dans la terre du
Mesnil-Guillaume. Ce fut lui qui fit construire le château existant aujourd’hui.
Il mourut sous le règne de Henri IV, laissant de son mariage avec Louise de la Vallette, trois filles entre lesquelles fut partagée sa succession, le 1er février 1606.
– L’aînée, Marie Le Vallois, avait épousé Charles Le Gouez, seigneur du Port;
– Marthe Le Vallois, la seconde, était mariée à Hilaire Le Viconte, seigneur de Vitty, un des ancêtres des marquis de Blangy;
– La troisième, Madelaine Le Vallois, épouse de Louis de la Haye, seigneur d’Harville, fils du seigneur de la Pipardière, devait mourir peu après sans
Postérité.
Ce fut à la dame du Port (L’aînée, Marie Le Vallois) qu’échurent la seigneurie et le château du Mesnil-Guillaume. Elle eut trois fils :
– Louis Le Gouez, l’aîné, fut seigneur du Port et du Mesnil-Guillaume;
– Charles, le second, eut le fief de Mainneville, situé à Saint-Lambert-sur-Dives;
– Jean Le Gouez, le plus jeune, posséda les seigneuries de Mondeville et d’Ifs; il épousa, en 1634, Claire Boutin, fille du seigneur de Victôt.
L’alliance du sieur du Port (Louis Le Gouez,) fut plus brillante encore : il obtint la main de Mademoiselle de Raveton, née du mariage de François de Raveton, seigneur de Chauvigny, chevalier de l’ordre du roi et gentilhomme de sa chambre, et de Marie Bruslart de Genlis, veuve de François, baron de Mailloc et de Cailly, dame d’honneur de la reine-mère. Une situation qui semblait ne lui laisser rien à désirer, ne fut cependant pour lui que l’occasion d’un crime odieux ; les souvenirs les plus sinistres sont restés inséparablement attachés à son nom.
Le beau-frère de Louis Le Gouez, Pierre de Raveton, seigneur de Chauvigny, était mort prématurément, laissant une fille unique, Marie de Raveton, de son mariage avec Anne de Pigace, héritière de la maison de Carentonne. Cette jeune
veuve convola à de secondes noces avec Jean de Mauduit, seigneur de la Rozière, conseiller-maître en la Chambre des Comptes de Normandie, veuf lui-même de Geneviève Halley, dont il avait plusieurs fils. La tutelle de la mineure fut alors confiée au plus proche parent paternel, qui était le sieur du Port (Louis Le Gouez,).
Cependant, quand la jeune fille, destinée à être un jour une riche héritière, approcha de l’âge où l’on pourrait disposer de son sort, l’inquiétude s’empara de plusieurs de ses parents.
Louis Le Gouez avait trois fils parvenus à l’âge d’homme; il passait pour peu scrupuleux, et l’on crut qu’il ne négligerait rien pour assurer à sa famille l’opulente succession qui se trouvait en quelque sorte entre ses mains.
Une délibération des parents confia d’abord la garde de la pupille à une tante, Marie de Raveton, abbesse de Lisieux; puis on la remit à l’abbesse de Saint-Amand de Rouen; enfin, en 1643, un jugement, rendu sur nouvel avis du conseil de famille, destitua le sieur du Port de ses fonctions de tuteur et les fit passer à M. de la Rozière.
Peu de temps après, l’héritière des Raveton épousait un fils du premier lit de celui-ci, Jacques Mauduit, seigneur du Renouard-sur-Coquainvilliers.
Frustré dans ses plus chères espérances, humilié d’une si amère déception, menacé d’un règlement de compte de tutelle, où il avait, disait-on, plus de 30,000 livres à rapporter, le seigneur du Mesnil-Guillaume livra son coeur à la rage. Accompagné de ses deux plus jeunes fils, il pénétra à main armée chez le sieur de la Rozière et l’immola à sa fureur, ainsi que Jacques de Mauduit, son fils. La jeune épouse elle-même, Marie de Raveton, ne fut pas épargnée; elle reçut des blessures mortelles, auxquelles elle ne tarda pas à succomber. Ce triple assassinat, accompli avec la plus
atroce barbarie, se termina par une scène de pillage; la maison des victimes fut saccagée, les meurtriers enlevèrent des meubles dont l’estimation fut portée à 12,000 livres.
Mais le châtiment ne se fit pas longtemps attendre; tombés aux mains de la justice, les Le Gouez, père et fils, expièrent leur abominable forfait par la mort la plus ignominieuse.
Le fils aîné du sieur du Port restait seul survivant; lieutenant d’une compagnie de chevau-légers au régiment de la Meilleraye.
François Le Gouez était aux armées pendant que s’accomplissait cette affreuse tragédie, et ne pouvait en être rendu responsable. La confiscation lui fut épargnée,
mais il n’en était pas moins ruiné par les restitutions et dommages qui tombaient à sa charge.
La terre du Mesnil-Guillaume fut expropriée par décret et adjugée à Louis, marquis de Rabodanges, en 1646.
François Le Gouez n’eut d’autre ressource que de réclamer l’héritage de la cousine que les siens avaient si cruellement égorgée.
[En 1645, des assassinats furent commis en grand chemin, à coups de fusil et de pistolet, sur Jean Mauduit, sieur de la Rosière, maître des Comptes, Anne de Pigace, sa femme, Jacques Mauduit, sieur de Regnouart, leur fils, avec enlèvement de la fille du sieur de la Rosière et de Marie de Raveton, femme du sieur de Regnouart. Ce qu’il y eut de remarquable dans ces assassinats, c’est qu’ils furent commis par des gentils-hommes avec l’aide de nombreux complices. Plusieurs des coupables échappèrent au châtiment par la fuite. Ceux qu’on réussit à saisir furent rompus vifs sur la place du Vieux-Marché de Rouen, « pour y finir leurs jours tant qu’il plairait à Dieu les leur prolonger. » Le château du Mesnil-Guillaume, dans lequel les assassins avaient conduit les deux femmes enlevées, dut être, aux termes de l’arrêt du 7 avril 1645, rasé complètement, à l’exception des bâtiments à usage de ferme, les fossés furent comblés, les canons et fauconneaux amenés à l’Hôtel-de-Ville de Rouen, les bois de haute futaie, qui servaient d’ornement au château, coupés à trois pieds de hauteur. 600 livres furent prélevées sur le prix de la confiscation pour la construction et dotation d’une chapelle à bâtir au lieu où le crime avait été commis (7 avril 1645) (Arch. de. la S.-Inf. Reg. de la Tournelle.). Précis analytique des travaux de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Rouen.]
Anne de Pigace y avait renoncé au nom de son fils mineur du second lit, Alexandre de Mauduit de Carentonne;.
Mais des collatéraux plus éloignés le revendiquèrent comme à eux dévolu par l’indignité des plus proches héritiers.
Après un long procès, le Parlement de Paris prononça, par arrêt du 18 janvier 1652, que François Le Gouez, n’ayant pas participé au crime, n’avait pas encouru l’indignité, bien qu’il représentât ceux qui l’avaient commis.
Accablé par de si douloureux souvenirs, ce nouveau seigneur de Chauvigny quitta l’épée pour embrasser l’état ecclésiastique et devint curé de Crulay, dans les environs de Laigle.
La terre du Mesnil-Guillaume ne resta pas longtemps dans la maison de Rabodanges. Elle fut vendue à Yves de Mailloc, sieur de Toutteville, le second des quatre fils de Philippe de Mailloc, seigneur des Éteux. Il mourut en 1694, à l’âge de cinquante-sept ans, et François de Mailloc-Toutteville, son fils, l’aliéna, en 1720, au profit de Joseph Durey de Sauroy, alors seigneur de Noinville et plus tard de Damville.
Celui-ci mourut en 1752, et le Mesnil-Guillaume fut de nouveau vendu par son fils, Joseph Durey, marquis du Terrail, maréchal de camp. Le nouvel acquéreur était M. Lemercier, ancien commandant de l’artillerie au Canada; cet officier estimé fut le dernier seigneur de cette terre.
Depuis la Révolution, elle a passé à la famille de Margeot, et a été rarement habitée par les propriétaires. Divers locataires en ont été, pendant de nombreuses années, les seuls occupants; parmi eux l’on peut citer la duchesse de Valmy, qui a passé plusieurs étés dans cette charmante habitation. Elle appartient aujourd’hui à Madame la comtesse Le Bel de Penguilly, née de Margeot, qui est venue y fixer sa demeure.
Vte L. Rioult De Neuville.
Extrait des chartes, et autres actes Normands ou Anglo-Normands à Calvados – Léchaudé d’Anisy, Amédée Louis.
N°. 115.- 13. Roger de Mesnil-Guillaume, donne, en novembre 1210, à l’hôpital Saint-Thomas-de-Lisieux six tennemens que Robert, fils d’Osmond, tenait de lui au
Mesnil-Guillaume et à Gloz. Cette donation, dont le sceau est brisé, contient une multitude de redevances et autres droits, dont le détail est assez curieux.
État faisant connaître la résidence actuelle des personnes évacuées de…. Seine-et-Oise, fasc.1 – Ministère de l’intérieur. Direction de la sureté générale.
1914.
Bruker (Aimée) et enf., d’Ezonville, à Mesnil-Guillaume, Calvados.
Dussart (Auguste) et fam., d’Auvers-sur-Oise, à Mesnil-Guillaume, Calvados.
Gamard (Eugénie), d’Ezanville, à Mesnil-Guillaume, Calvados.
Fonds Studio Sturler Photos Et Pellicules
29 O Cidreries de Mesnil-Guillaume nov 1963
BOITE 29 – 2 pell matériel (?)
Fonds Caillaux – 3F
– 3F 88 – 1756-1868 – Mesnil-Guillaume : cession d’un moulin à papier, annexe de l’usine
Dallencon Vve
Dubosq Nicolas
– 3F 89 – 1838-1867 – Mesnil-Guillaume : réglementation d’eau des usines
– 3F 172 – 1751-1769 – Saint-Martin-de-Mailloc – Lisieux : partage de biens, rente
Le Camus Fançois
Dubos Nicolas, papetier au Mesnil-Guillaume
Analyses Et Transcriptions De Documents Originaux, Aveux De Fiefs.
12 juillet 1617 – jugement d’adjudication des immeubles décrétée sur sieur Jehan DENDELET, assis et situés en la paroisse du RONCEREY, à la requête de Jehan de QUERVILLE lequel s’est rendu adjudicataire des biens décrétés conjointement avec Jacques de LA ROCHE, escuyer sieur de LAPLESSE, en qualité de procureur de la dame du Mesnil-Guillaume.
1 mai 1557 – Echange entre Jehan MOREL boulanger dans la paroisse de Glos et noble homme Me Jehan de FRANQUEVILLE licencié en loys sieur de COULANDON de 5 pièces de terre assises en la paroisse de Mesnil-Guillaume contre une rente de 7 livres tournois et 1 chapon ( passé dans l’Hostel de la Sallamandre à Lisieux)
22 février 1709 – Transport fait devant les tabellions d’Orbec, par Messire François de Mailloc, chevalier, seigneur de Touteville (?), Mesnil-Guillaume et autres terres et seigneuries, demeurant ordinairement dans son château du Mesnil-Guillaume , étant présent à Orbec, à Charles Mahieu, marchand bourgeois dudit Orbec, d’une rente de 111 livres constituée au denier 18, à prendre sur Dames Catherine et Françoise Seney soeurs, demeurant à Lisieux, paroisse Saint-Germain, suivant contrat passé le 3 août 1699
1613 19 juillet
Aveu rendu à damoiselle Marie Le Valois veuve de feu Charles le Goys vivant escuyer, sieur du Parc et de Menneville, dame du fief noble, terre et sieurie du Mesnil-Guillaume par Jehan le Charetier, Laurens de la Mare et Robert Haguelon, pour une aînesse nommée la Boucqueterye, assise en ladite paroisse de Mesnil-Guillaume, contenant 4 acres, sujette à 20 sols tournois, au terme Saint-Michel et à Noël 2 chapons, 2 deniers de rente avec foy, hommages reliefs treizièmes service de prévosté en son rang et degré, regard de mariage, suivre le baou du moulin, aider au pied à perche du curage des fossés qui sont autour du manoir sieurial dudit lieu, le tout comme les autres hommes de la sieurie.
Fonds Etienne Deville
Carton n°11
C11/12 – Fiches manuscrites sur Mesnil-Guillaume.
Fonds F1
– 1F284 : 17 juin 1776: accord entre François Lemercier seigneur de Mesnil Guillaume, Jacques Rayer officier de la milice de Caen et Charles Dubois notaire à Glos à propos du paiement de rente ¬sur les Bruyères de Glos; témoins Pierre Moisy et Pierre Pinel.
– 1F819 : Le Mesnil Guillaume : moulins à papier.

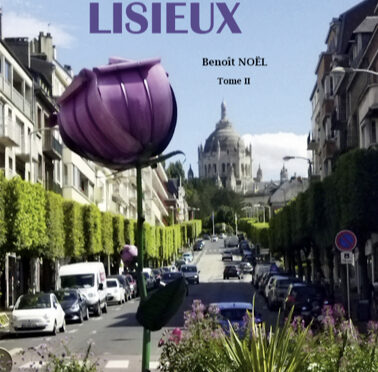
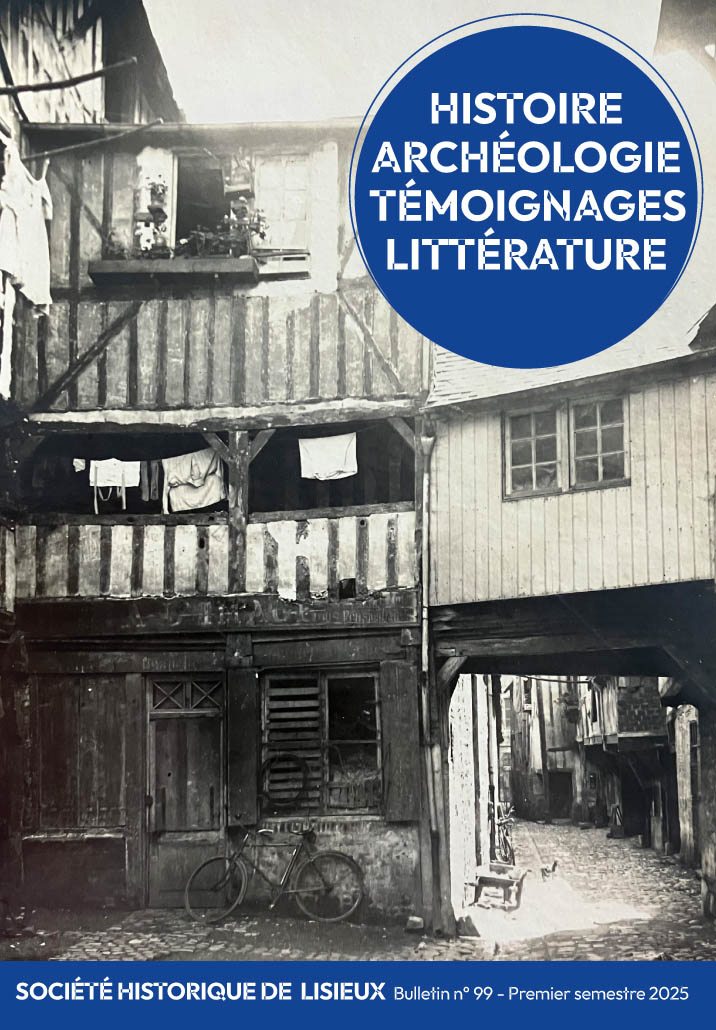
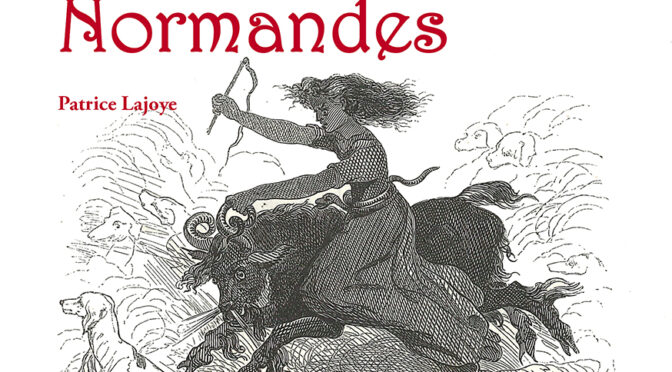
Laisser un commentaire